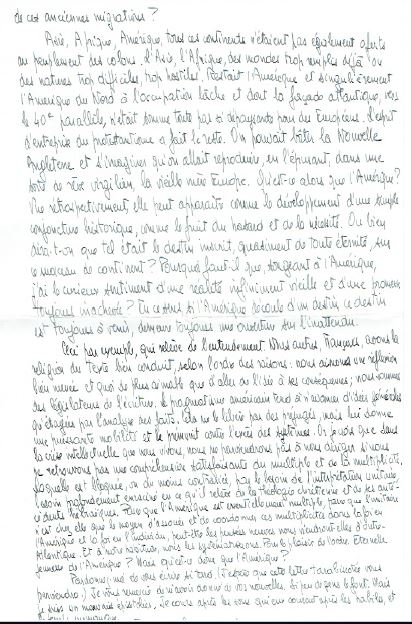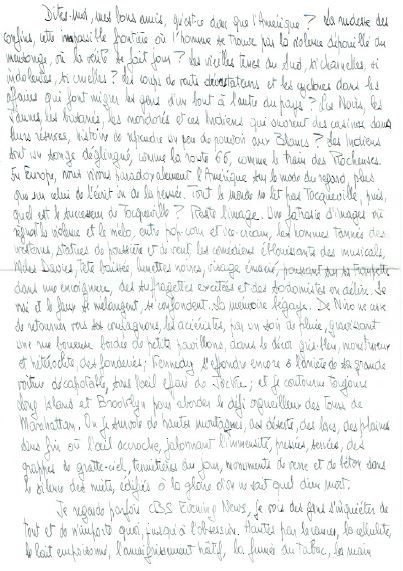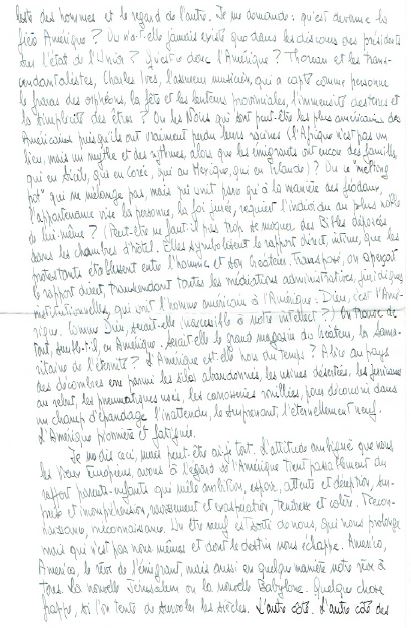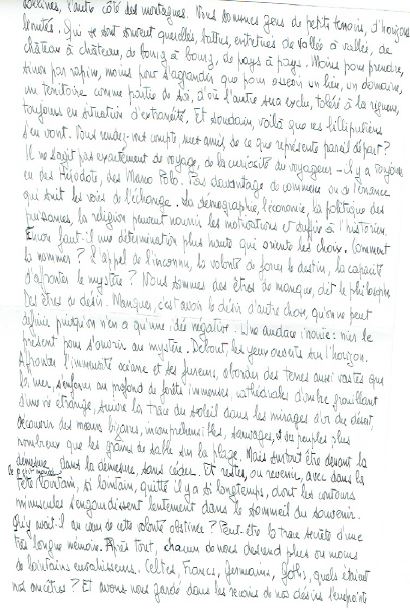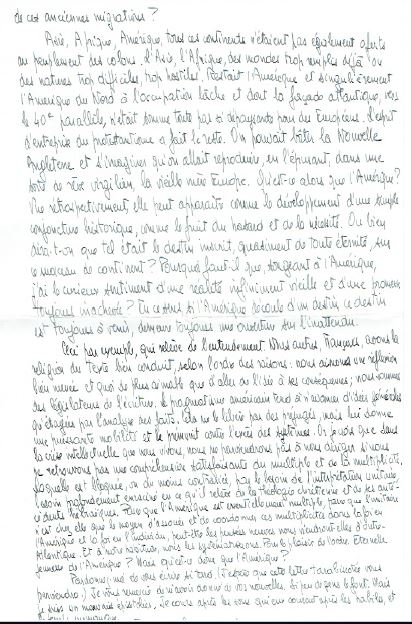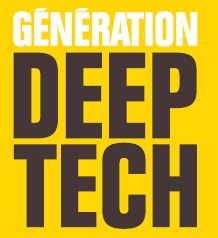En examinant de vieilles archives, j’ai redécouvert une lettre écrite par un membre de la famille en octobre 1993. À l’époque, je vivais en Californie. Je l’ai relue, l’ai tellement adorée pour des raisons personnelles, mais aussi l’ai trouvée si clairvoyante que j’ai décidé de la partager ici. J’espère que certains l’aimeront.
Dites-moi, mes bons amis, qu’est-ce donc que l’Amérique ? La rudesse des confins, cette impossible frontière où l’homme se trouve par la violence dépouillé du mensonge, où la vérité se fait jour ? Les vieilles terres du sud, si charnelles, si indolentes, si cruelles ? Les coups de vents dévastateurs et les cyclones dans les affaires qui font migrer les gens d’un bout à l’autre du pays ? Les Noirs, les Jaunes, les basanés, les mordorés et ces Indiens qui ouvrent des casinos dans leurs réserves, histoire de reprendre un peu de pouvoir aux Blancs ? Les Indiens sont un songe déglingué, comme la route 66, comme le train des Rocheuses. En Europe, nous vivons paradoxalement l’Amérique sur le mode du regard, plus que sur celui de l’écrit ou de la pensée. Tout le monde ne lit pas Tocqueville, puis, quel est le successeur de Tocqueville ? Reste l’image. Une fatrasie d’images où régnait la violence et le mélo, entre pop-corn et ice-cream, les hommes tannés des westerns, statues de poussière et de vent, les comédiens éblouissants des musicals, Miles Davies, tête baissée, lunettes noires, visage émacié, poussant sur sa trompette dans une encoignure, des suffragettes excitées et des sodomites en délire. Le vrai et le faux de mélangent, se confondent. La mémoire bégaye. De Niro ne cesse de retourner vers ses compagnons, les aciéristes, par un soir de pluie, gravissant une rue boueuse bordée de petits pavillons, dans le décor gris-bleu, monstrueux et hétéroclite, des fonderies ; Kennedy s’effondre encore à l’arrière de sa grande voiture décapotable, sous l’œil effaré de Jackie ; et je contourne toujours Long Island et Brooklyn pour aborder le défi orgueilleux des tours de Manhattan. Ou je survole de hautes montagnes, des déserts, des lacs, des plaines sans fin, où l’œil accroche, jalonnant l’immensité, pressées, serrées, des grappes de gratte-ciel, termitières du jour, monuments de verre et de béton dans le silence des nuits, édifiés à la gloire dont ne sait quel dieu mort.
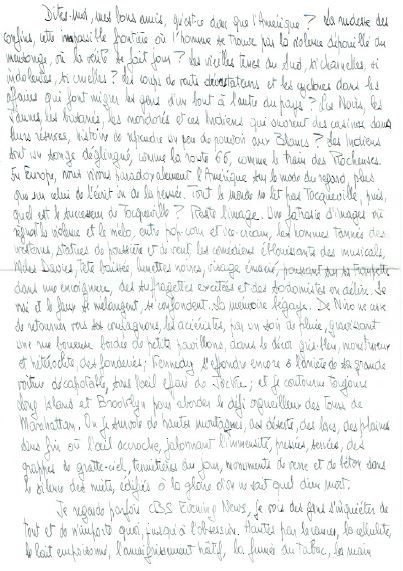
Je regarde parfois CBS Evening News, je vois des gens s’inquiéter de tout et de n’importe quoi, jusqu’à l’obsession. Hantés par le cancer, la cellulite, le lait empoisonné, l’amaigrissement hâtif, la fumée de tabac, la main lest des hommes et le regard de l’autre. Je me demande : qu’est devenue la fière Amérique ? Ou n’a-t-elle jamais existé que dans les discours des présidents sur l’état de l’Union ? Qu’est-ce donc l’Amérique ? Thoreau et les transcendantalistes, Charles Ives, l’assureur musicien, qui a capté comme personne le fracas des orphéons, la fête et les lenteurs provinciales, l’immensité des terres et la simplicité des êtres ? Ou les Noirs qui sont peut-être les plus américains des Américains puisqu’ils ont vraiment perdu leurs racines (l’Afrique n’est pas lieu, mais un mythe et des rythmes alors que les émigrants ont encore des familles, qui en Sicile, qui en Corée, qui au Mexique, qui en Irlande) ? Ou ce « melting pot » qui ne se mélange pas, mais qui unit parce qu’à la manière des féodaux, l’appartenance vise les personnes, la foi jurée, requiert l’individu au plus noble de lui-même ? (Peut-être ne faut-il pas trop se moquer des Bibles déposées dans les chambres d’hôtel. Elles symbolisent le rapport direct, intime que les protestants établissent entre l’homme et son créateur. Transposé, on aperçoit le rapport direct, transcendant toutes les médiations administratives, juridiques, institutionnelles, qui unit l’homme américain à l’Amérique : Dieu, c’est l’Amérique. Comme Dieu, serait-elle inaccessible à notre intellect ?) On trouve de tout, semble-t-il en Amérique. Serait-elle le grand magasin du créateur, la Samaritaine de l’éternité ? L’Amérique est-elle hors du temps ? Alice au pays des décombres erre parmi les silos abandonnés, les usines désertées, les jerricanes au rebut, les pneumatiques usés, les carrosseries rouillées, pour découvrir dans un champ d’épandage l’inattendu, le surprenant, l’éternellement neuf. L’Amérique pionnière et fatiguée.
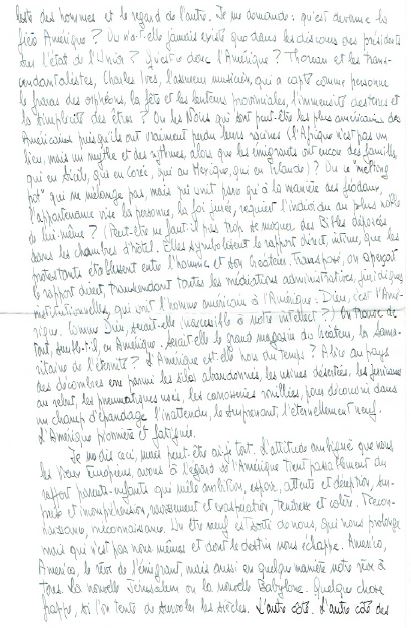
Je me dis ceci, mais peut-être ai-je tort. L’attitude ambigüe que nous les Vieux Européens avons à l’égard de l’Amérique tient passablement du rapport parents-enfants qui mêle ambition, espoir, attente et déception, surprise et incompréhension, ravissement et exaspération, tendresse et colère. Reconnaissance, méconnaissance. Un être neuf est sorti de nous, qui nous prolonge mais qui n’est pas nous-mêmes et dont le destin nous échappe. America, America, le rêve de l’émigrant, mais aussi en quelque manière notre rêve à tous. La nouvelle Jérusalem ou la nouvelle Babylone. Quelque chose frappe, si l’on tente de survoler les siècles. L’autre côté. L’autre côté des collines, l’autre côté des montagnes. Nous sommes gens de petits témoins, d’horizons limités. Qui se sont souvent querellés, battus, entretués de vallée à vallée, de château à château, de bourg à bourg, de pays à pays. Moins pour prendre, sinon par rapine, moins pour s’agrandir que pour asseoir un lieu, un domaine, un territoire comme partie de soi, d’où l’autre sera exclu, toléré à la rigueur, toujours en situation d’extranéité. Et soudain, voilà que ces Lilliputiens s’en vont. Vous rendez-vous compte, mes amis, de ce que représente pareil départ ? Il ne s’agit pas exactement de voyage, de la curiosité du voyageur – il y a toujours eu des Hérodote, des Marco Polo. Pas davantage de commerce ou de l’errance qui suit les voies de l’échange. La démographie, l’économie, la politique des puissances, la religion peuvent nourrir les motivations et suffire à l’historien. Encore faut-il une détermination plus haute qui oriente les choix. Comment la nommer ? L’appel de l’inconnu, la volonté de force le destin, la capacité d’affronter le mystère ? Nous sommes des êtres de manque, dit le philosophe. Des êtres de désir. Manquer, c’est avoir le désir d’autre chose, qu’on ne peut définir puisqu’on en a une idée négative. Une audace inouïe : nier le présent pour s’ouvrir au mystère. Debout, les yeux ouverts sur l’horizon. Affronter l’immensité océane et ses fureurs, aborder des terres aussi vastes que la mer, s’enfoncer au profond de forêts immenses, cathédrales d’ombre grouillant d’une vie étrange, suivre la trace du soleil dans les mirages d’or du désert, découvrir des mœurs bizarres, incompréhensibles, sauvages, et des peuples plus nombreux que les grains de sable sur la plage. Mais surtout être devant la démesure dans la démesure dans céder. Et rester, ou revenir, avec dans la tête, le petit monde lointain, si lointain, quitté il y a si longtemps, dont les contours minuscules s’engourdissent lentement dans le sommeil du souvenir. Qu’y avait-il au cœur de cette volonté obstinée ? Peut-être la trace secrète d’une très longue mémoire. Après tout, chacun de nous descend plus ou moins de lointains envahisseurs. Celtes, Francs, Germains, Goths, quels étaient nos ancêtres ? Et avons-nous gardé dans les recoins de nos désirs l’empreinte de ces anciennes migrations ?
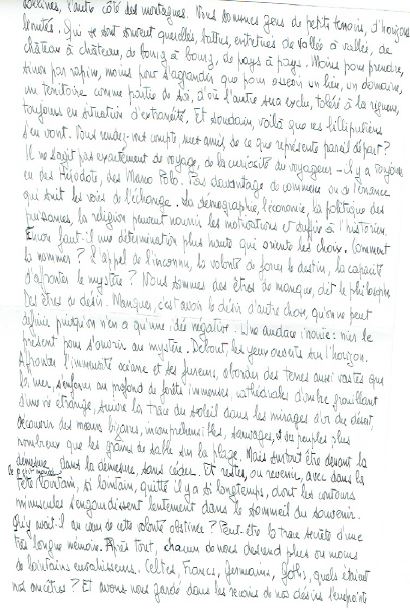
Asie, Afrique, Amérique, tous ces continents n’étaient pas également offerts au peuplement des colons. L’Asie, l’Afrique, des mondes trop remplis déjà ou des natures trop difficiles, trop hostiles. Restait l’Amérique et singulièrement l’Amérique du Nord à l’occupation lâche et dont la façade atlantique, vers le 40e parallèle, n’était somme toute pas si dépaysante pour des Européens. L’esprit d’entreprise du protestantisme a fait le reste. On pouvait bâtir sa Nouvelle Angleterre et s’imaginer qu’on allait reproduire en l’épurant dans une sorte de rêve virgilien la vieille mère Europe. Qu’est-ce alors que l’Amérique ? Vue rétrospectivement, elle peut apparaître comme le développement d’une simple conjoncture historique, comme le fruit du hasard et de la nécessité. Ou bien dira-t-on tel était le destin inscrit, quasiment de toute éternité, sur ce morceau de continent ? Pourquoi faut-il, que songeant à l’Amérique, j’ai le sentiment d’une réalité infiniment vieille et d’une promesse toujours inachevée ? En ce sens, si l’Amérique découle d’un destin, ce destin est toujours à venir, demeure toujours une ouverture sur l’inattendu.
Ceci par exemple, qui relève de l’entendement. Nous autres, Français, avons la religion du texte bien conduit, selon l’ordre des raisons : nous aimons une réflexion bien menée et quoi de plus aimable que d’aller de l’idée à ses conséquences ; nous sommes des législateurs de l’écriture. Le pragmatisme américain tend à n’avancer d’idées générales qu’étayées par l’analyse des faits. [C’est moi qui souligne.] Cela ne le libère pas de préjugés, mais lui donne une puissante mobilité et le prémunit contre l’excès des systèmes. Or je crois que dans la crise intellectuelle que nous vivons, nous ne parviendrons pas à nous diriger si nous ne retrouvons pas une compréhension satisfaisante du multiple et de la multiplicité, laquelle est bloquée, ou du moins contrariée, par le besoin de l’interprétation unitaire, besoin profondément enraciné en ce qu’il relève de la théologie chrétienne et de ses antécédents hébraïques. Parce que l’Amérique est essentiellement multiple, parce que l’unitaire n’est chez elle que le moyen d’associer et de coordonner ces multiplicités dans la foi en l’Amérique et la foi en l’individu, peut-être les pensées neuves nous viendront-elles d’outre-Atlantique. Et à notre habitude, nous les systématiserons. Pour le plaisir de l’ordre. Éternelle jeunesse de l’Amérique ? Mais qu’est-ce donc que l’Amérique.
Pardonnez-moi de vous écrire si tard. (J’espère que cette lettre tarabiscotée vous parviendra.) Je vous remercie de m’avoir donné de vos nouvelles. Si peu de gens le font. Mais je suis un mauvais épistolier. Je cours après les sous qui eux courent après les habiles et le temps me manque.
Je vous embrasse,
Georges, le 2 octobre 1993.