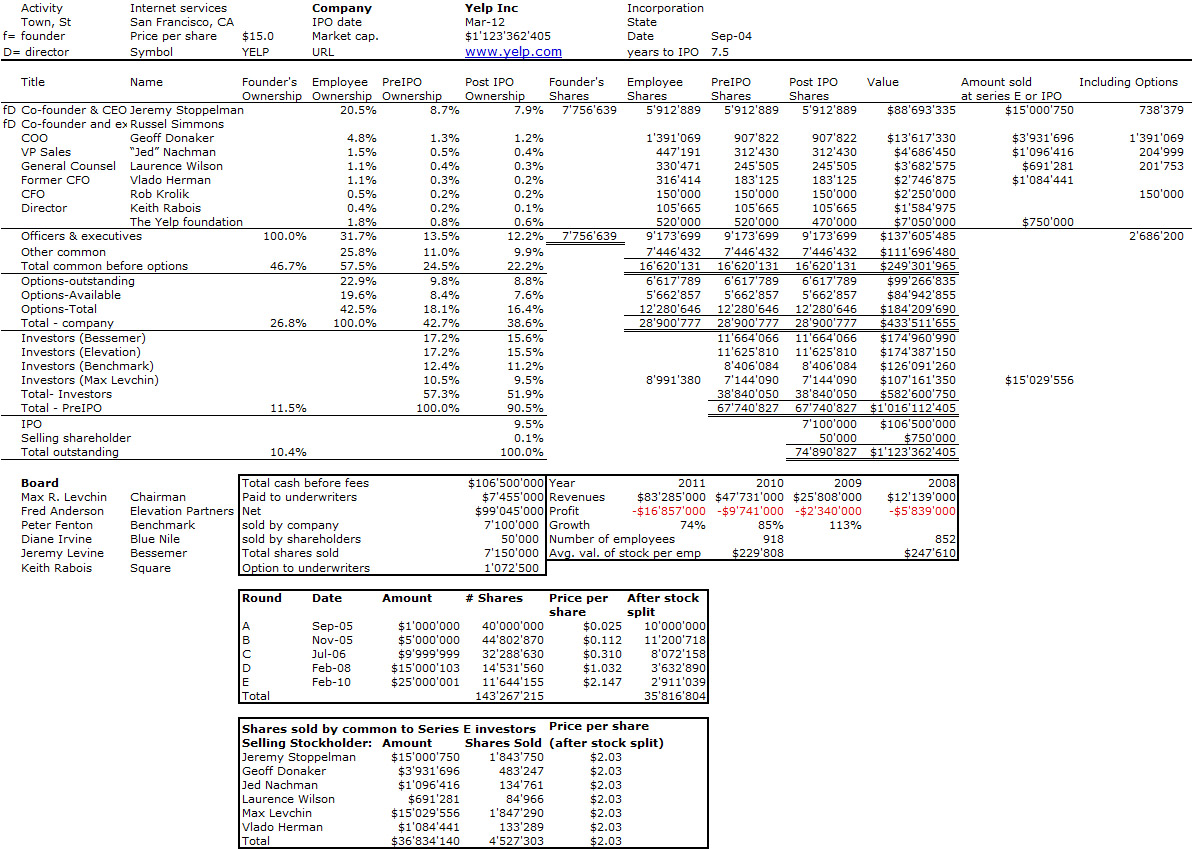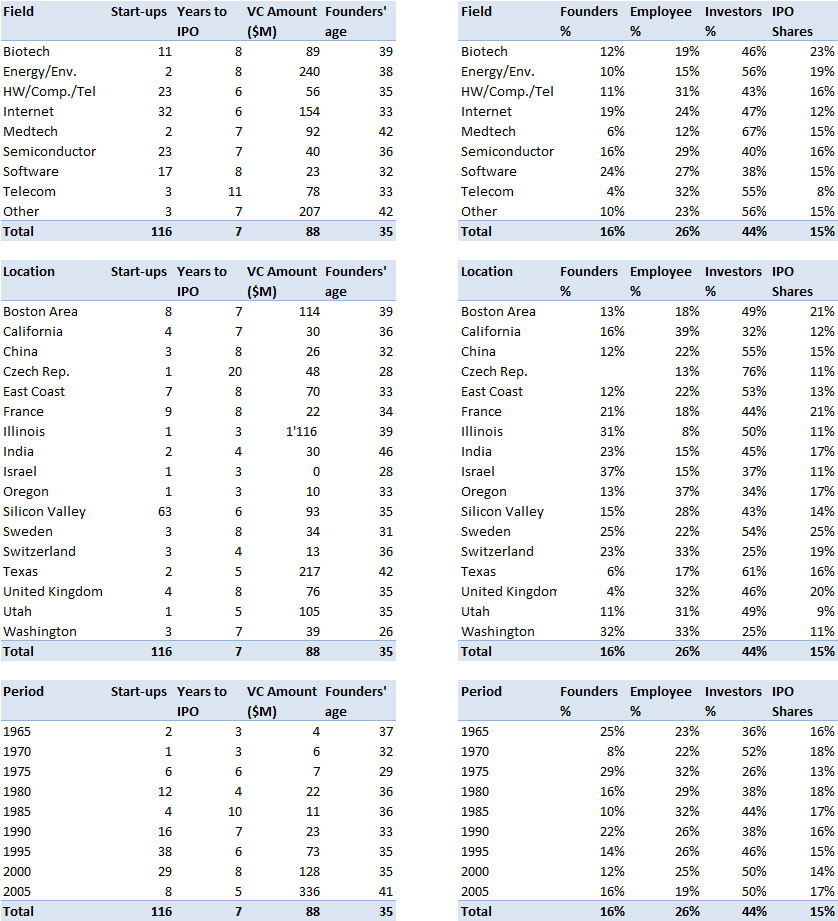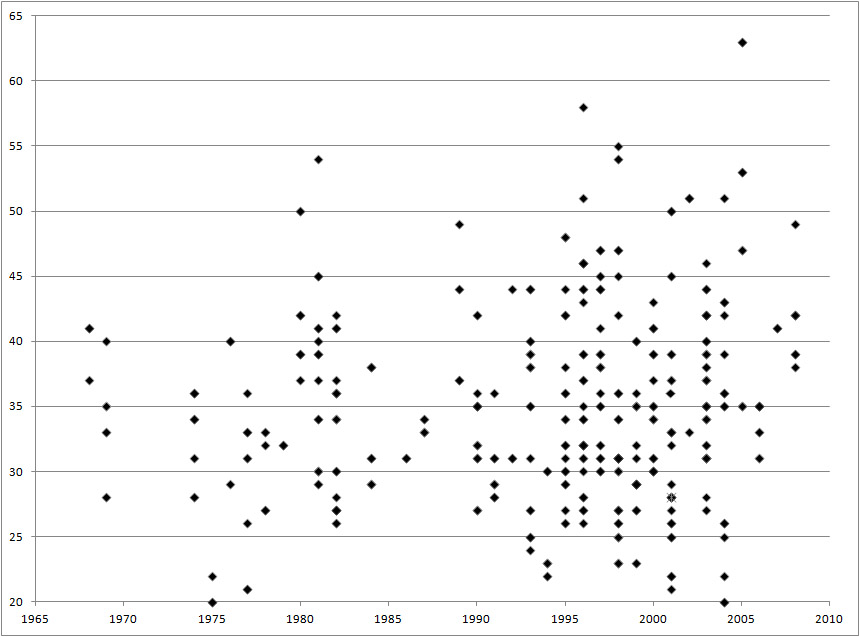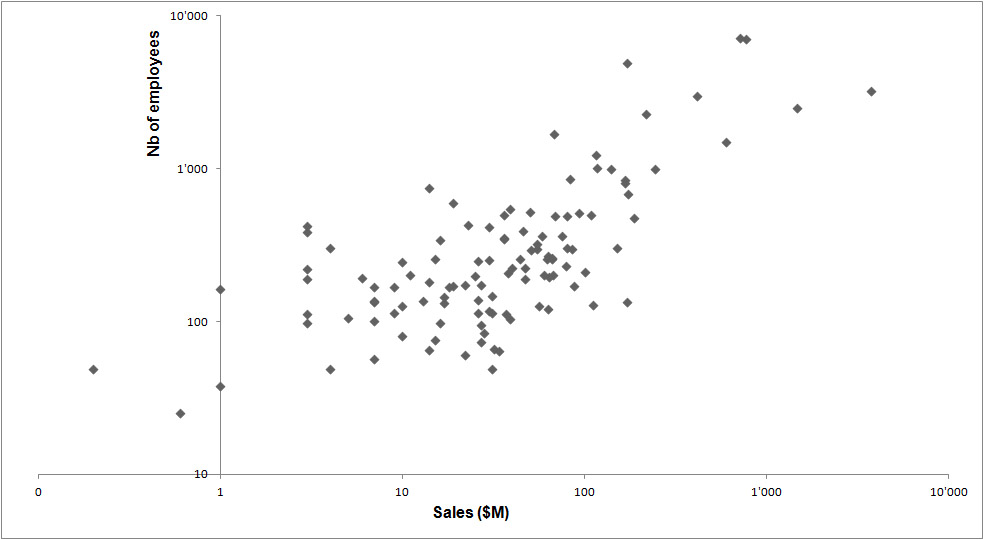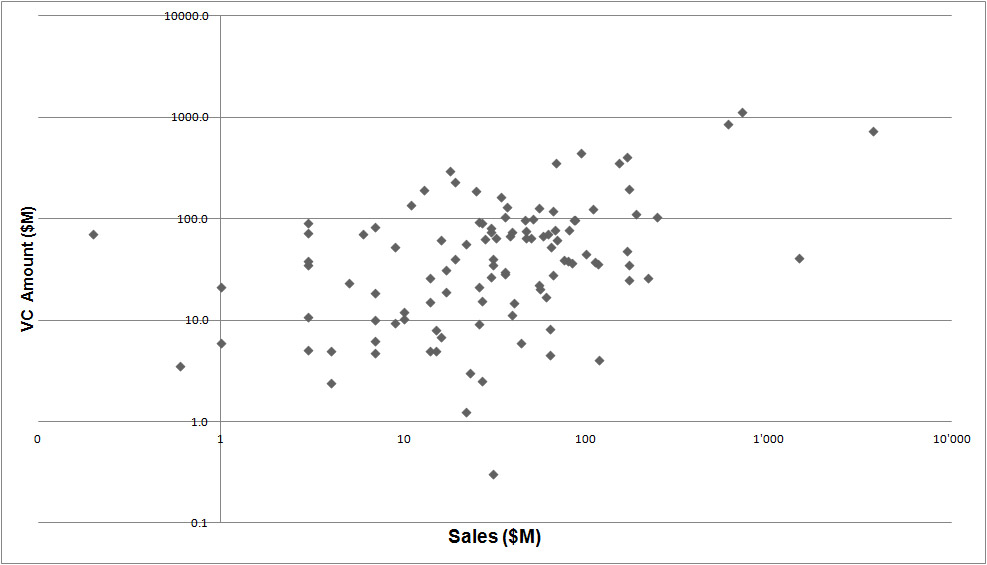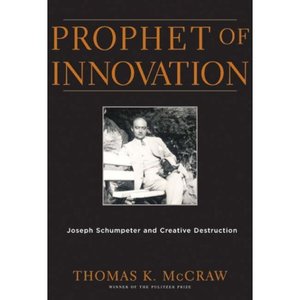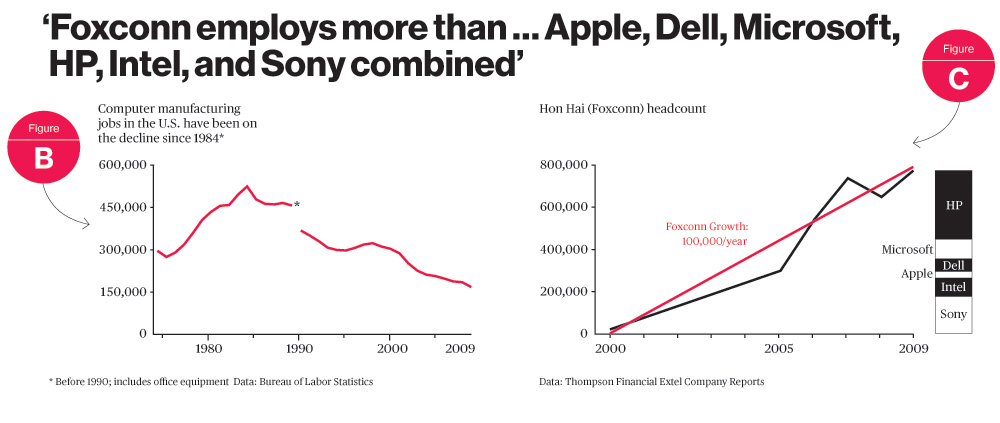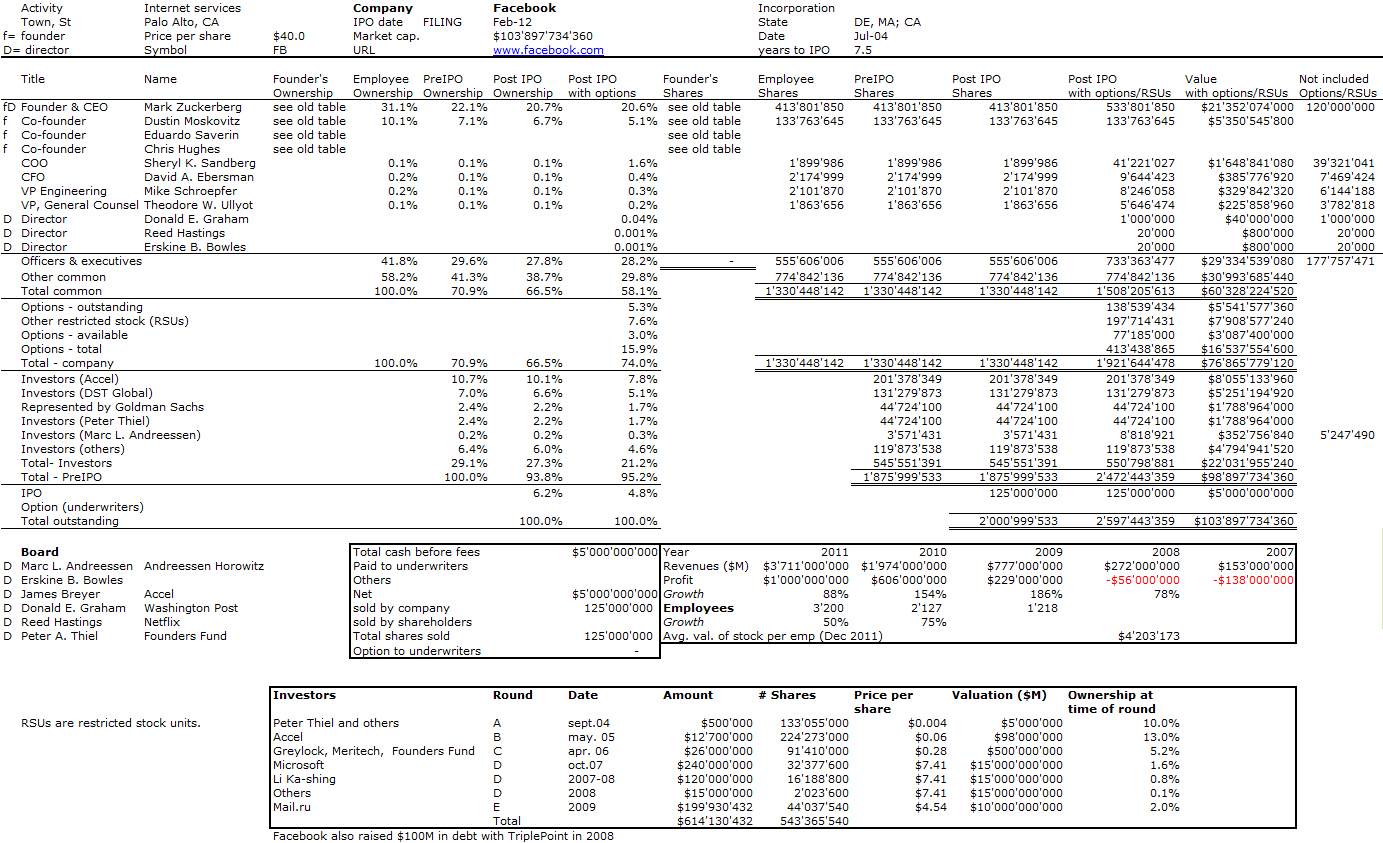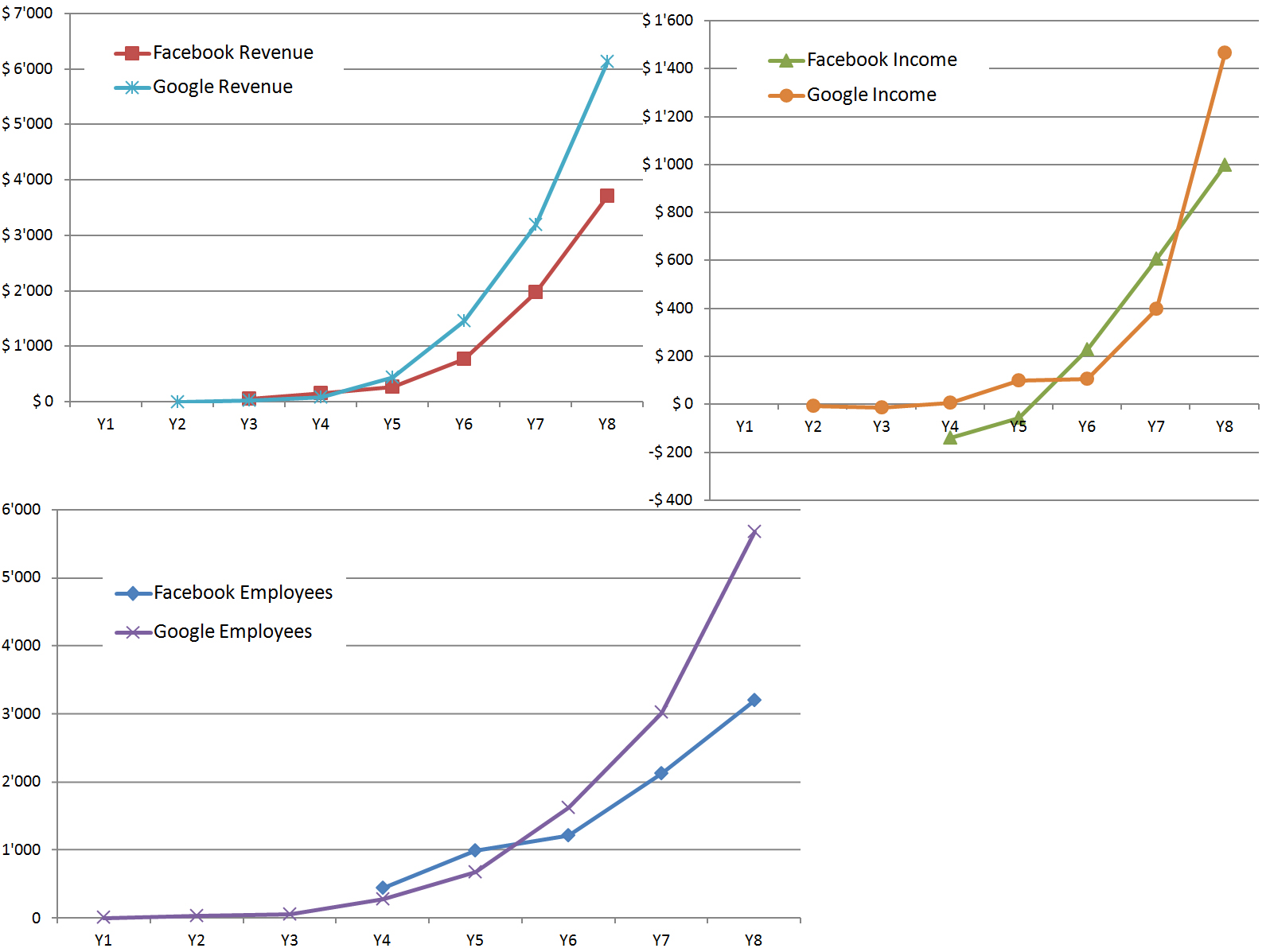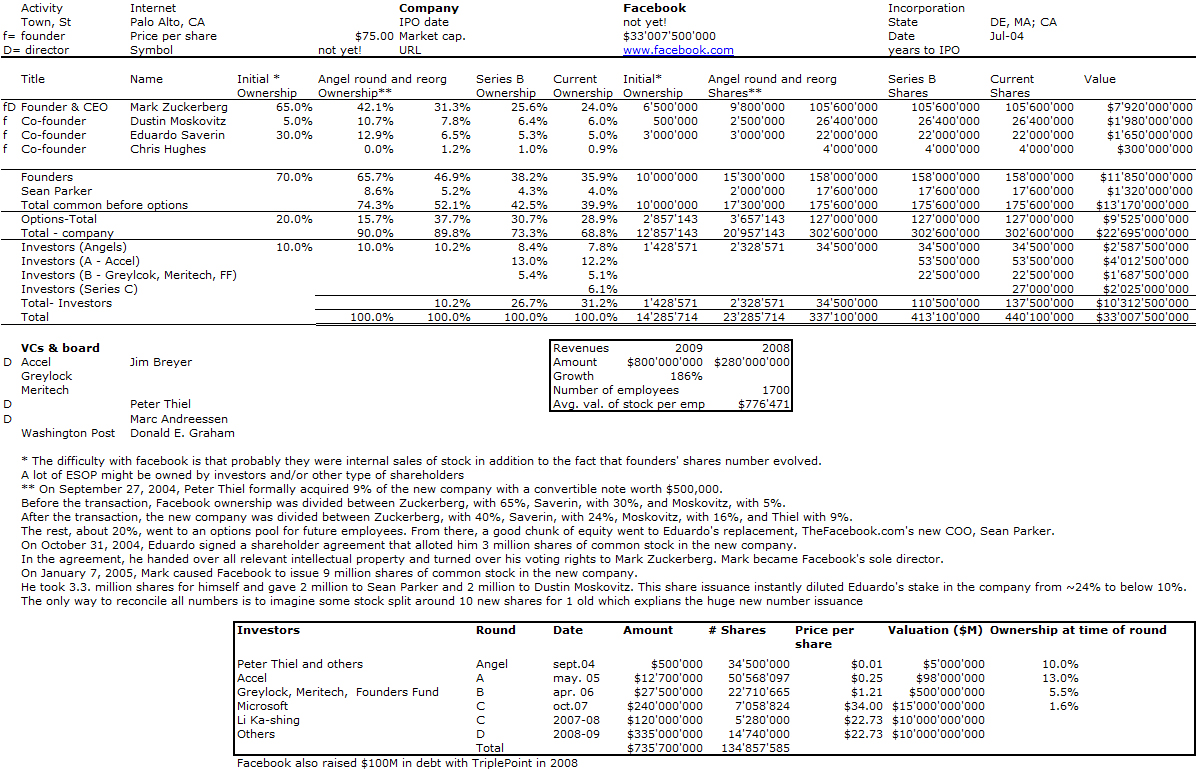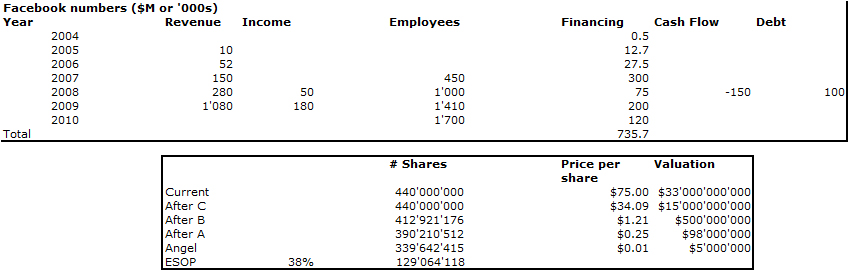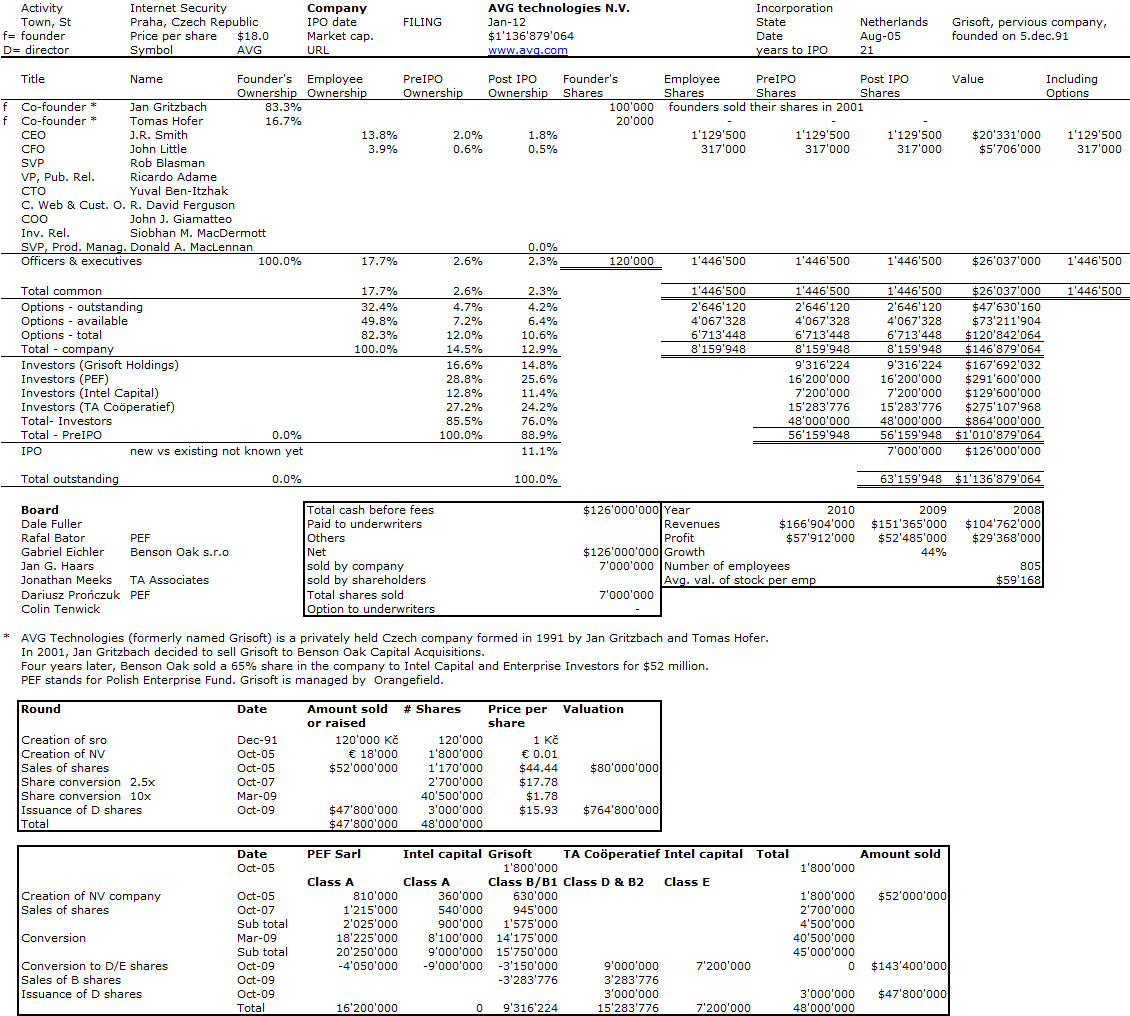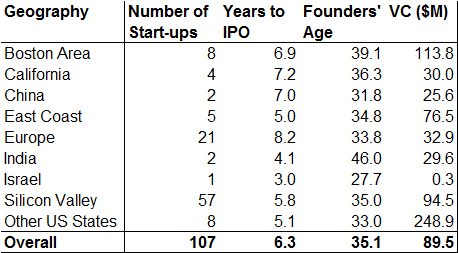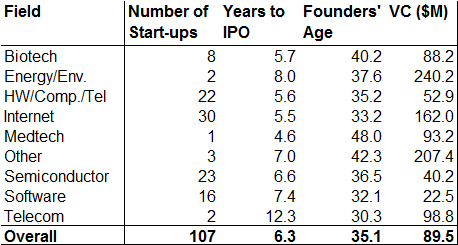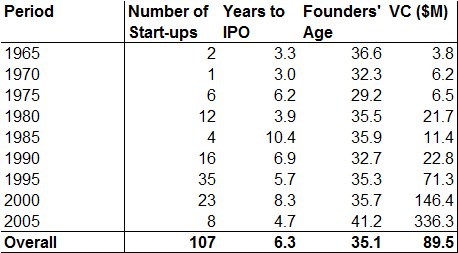Je viens de regarder Something Ventured et je l’ai adoré. Tellement aimé que j’espère le montrer au plus grand nombre possible d’étudiants de l’EPFL ce printemps! Il s’agit d’un film sur la passion, l’enthousiasme, l’énergie, sur la volonté de changer le monde et … oui aussi sur l’argent. Questionnés sur leur ambition sur le film, les producteurs Molly Davis et Paul Holland ont dit: Notre grand espoir pour ce film est que chaque élève qui veut être un entrepreneur – à tous les niveaux, l’école secondaire, les écoles de commerce, et même dans l’entreprise – puisse le voir. Je veux voir plus de jeunes se passionner pour l’esprit d’entreprise … Et si j’ai un objectif moins passionné, plus sérieux, c’est que je veux que les décideurs examinent cette question et disent : « Que pouvons-nous faire pour qu’il soit plus facile, et non pas plus difficile, pour les personnes dans ce pays pour lancer ce genre d’entreprises?

Je dirais même que je rêve que tout étudiant – à quelque niveau que ce soit- le voit. Et les producteurs d’ajouter : Nous avons essayé d’expliquer notre vision pour le film : « Ce que nous envisageons est un film comme Reds [Le film de Warren Beatty en 1981 sur le communisme], où vous remontez dans le temps pour décrire un épisode passionnant de l’histoire – ici la Russie de 1917 – puis demander aux mêmes acteurs ce que c’était à l’époque. Dan a dit: « Ok, vous voulez faire Reds, mais sans les communistes. » C’est en définitive ce qui s’est passé : un très beau dialogue avec des hommes vraiment intéressants et les personnes qu’ils ont financées.
« Un film sur le capitalisme, et (surprise) c’est une histoire d’amour. »
C’est le titre d’un autre article sur le film, où le journaliste dit les cinéphiles peuvent voir ce qui pourrait être un des oiseaux les plus rares dans le monde du documentaire: une véritable histoire d’amour pour le capitalisme. Ailleurs, la cinéaste, Dayna Goldfine, explique: Je pense que ce qui nous a motivé, même si c’est en effet une description positive de l’entreprise, était, un, une occasion de donner un point de vue alternatif. Mais aussi, ce que ces gens faisaient-aussi bien les entrepreneurs que capital-risqueurs- était de créer de vrais produits. Il y tellement eu de nouvelles négatives à la suite de la tragédie financière de ces dernières années causée par les banques, et ces gens qui ont juste créé des instruments financiers, par opposition à changer le monde avec la technologie en créant ou en finançant les ordinateur d’Apple, les routeurs de Cisco Systems, ou les molécules de Genentech. Le co-cinéaste Dan Geller ajoute: Je ne dirais pas que l’argent était accessoire – l’argent était important -, mais l’enthousiasme débordait pour partir de ces idées brillantes et ces technologies assez frustres pour en faire quelque chose de révolutionnaire. C’est cette énergie, je pense, qui ressort à travers ces histoires.

Oui c’est un film sur le capitalisme et les affaires. Mais c’est aussi un film sur l’enthousiasme, le bonheur, l’échec aussi. Il commence en 1957 avec Fairchild et Arthur Rock. Il aurait pu commencer avec le français expatrié Georges Doriot. Un professeur à Harvard qui soi-disant enseigné les techniques de production (en fait, il expliquait combien de verres boire lors d’un cocktail et comment lire les journaux – aller aux nécrologies), Doriot n’a pas créé le capital-risque avec ARD (même si il a financé Digital Equipment – DEC) – Rock a créé le terme plus tard, mais Doriot a inspiré la plupart des héros du film: Tom Perkins, Bill Draper, Pitch Johnson, Dick Kramlich. Et ces gens-là ont financé Intel, Atari, Apple, Tandem, Genentech, Cisco. (Le film raconte des histoires des années 60 aux années 80, mais Google, Yahoo, Amazon, Facebook auraient pu être ajoutés). En effet, avec le film, Le Réseau Social, c’est le meilleur film que j’ai vu sur les entreprises de haute technologie. J’avais presque oublié dans le Réseau Social à quel point la société Bostonienne est close (cf les efforts désespérés de Zuckerberg pour entrer dans l’élite des clubs sociaux). Ici aussi, le Wild West explique son succès par l’ouverture et la prise de risque.
Et les auteurs ne trichent pas. Il est aussi question de souvenirs douloureux, comme par exemple l’histoire de Powerpoint qui a terminé dans les mains de Microsoft, peut-être parce que l’entrepreneur avait trouvé trop dure son aventure ou comment l’un des rares femmes dans ce monde, Sandy Lerner, la co-fondatrice de Cisco, n’a peut-être toujours pas pardonné son licenciement par la compagnie qu’elle avait créée: vous devez comprendre dans quel jeu vous êtes […] Regardez, il n’y avait pas de case pour moi. Alors oui, il est également question d’échecs, de morts vivants, mais il y a un sentiment de joie, une feel good attitude, et des moments (très) drôles, comme lorsque Don Valentine visite l’usine d’Atari et ne reconnaît pas les marques de cigarettes qu’il fume! Ou quand Gordon Moore (la fameuse loi de Moore) se souvient qu’Intel est entrée en bourse le même jour que PlayBoy.

Donc, si vous ne connaissez pas (ou même si vous en savez beaucoup sur) Fairchild, Intel, Atari, Tandem, Genentech, Apple, Cisco, et même si vous ne se souciez pas de l’esprit d’entreprise, allez vite voir Something Ventured. Espérons que vous vous en soucierez ensuite!