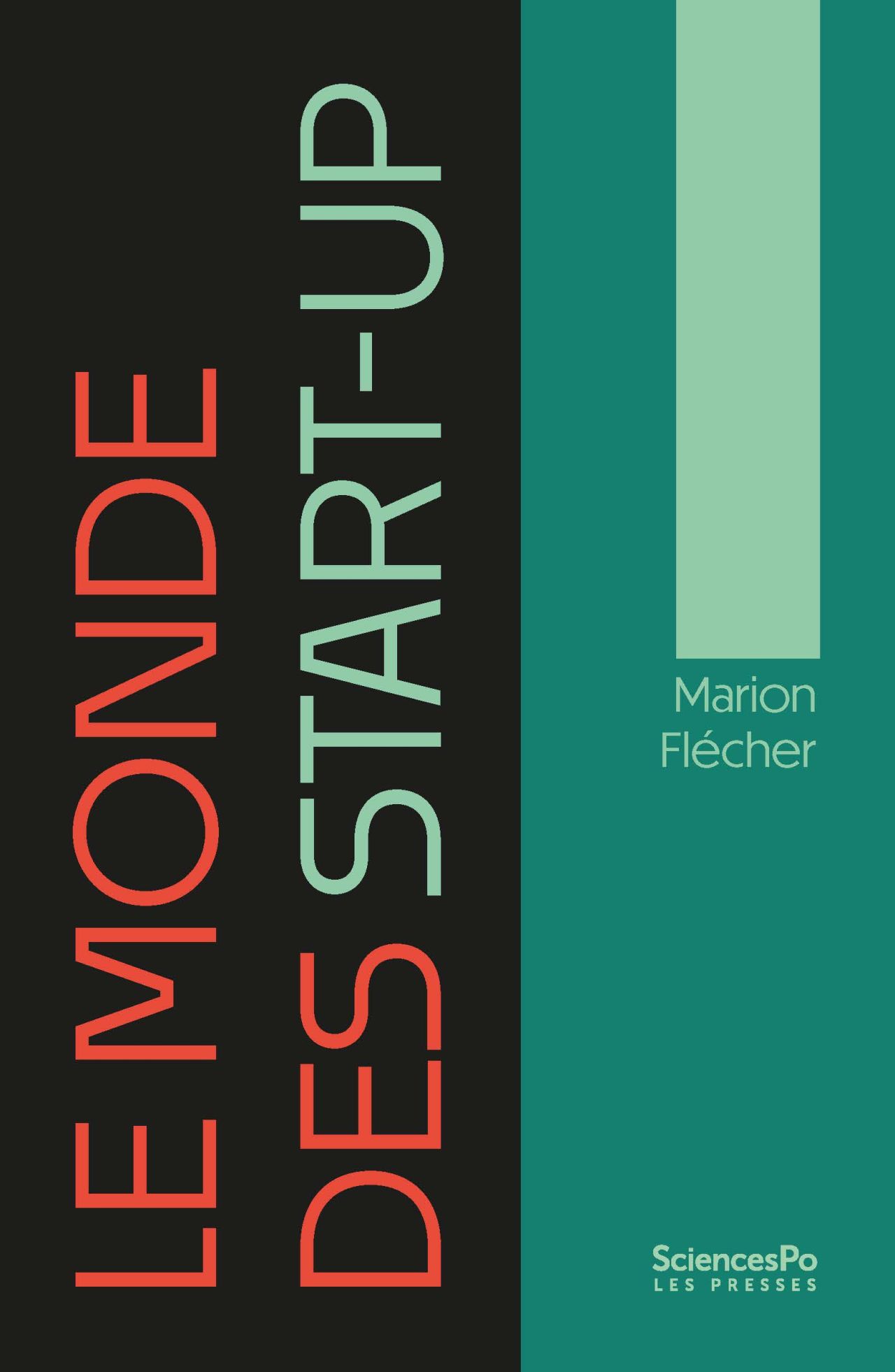Je viens de terminer la lecture du Monde des Startup par Marion Flécher et je confirme que c’est un excellent ouvrage même s’il est par moments un peu déprimant, j’y reviendrai. J’avais dans un précédent post décrit son travail de comparaison entre startup françaises et startup « siliconiennes ». Mais le coeur de son travail de recherche traite d’une part d’une sociologie des entrepreneurs qui semble pour avoir comme résultat de briser le mythe du self-made man et d’autre part du fonctionnement interne des startup qui serait bien loin de la « coolitude » douce et colorée de ses soi-disant entreprises libérées.
Une sociologie des entrepreneurs
Marion Flécher critique l’idée que l’entrepreneur ne devrait son succès qu’à son mérite [page 83]. Elle l’illustre par le niveau d’études de cette population. 92% ont un diplôme universitaire du 2ème ou 3ème cycle (contre 27% des créateurs d’entreprises classiques). Elle l’illustre également par le fait qu’une grande majorité occupait un emploi salarié avant de se lancer dans la création d’entreprise [page 87].
Ensuite, tous ces entrepreneurs ont profité d’un écosystème soutenu par l’État notamment à travers la multitude des initiatives de BPIFrance (pour se former, pour rencontrer des personnes et pour trouver des subventions sans lesquelles seuls des personnes très à l’aise financièrement pourraient se lancer). Il y a là une analyse bourdieusienne qui montre que les entrepreneurs disposent de capital économique, social et culturel.
Elle revient de manière convaincante sur une analogie avec le monde de l’art : de la même façon que l’artiste ne crée pas l’œuvre d’art seul dans on atelier, les fondateurs et fondatrices de start-up ne créent pas leur entreprise de manière isolée [page 97].
De ce fait, les discriminitions sociales des sociétés occidentales sont amplifiées ici. Discrimination de genre, bien sûr: Manon Flécher a cette expression Entrepreneuriat + Innovation technologique = sexisme au carré [page 109]. Mais aussi discriminations géographiques : le monde des startup est très urbain, bourgeois. Rares sont les entrepreneurs issus des banlieues qui n’ont ni les codes, ni les informations et réseaux.
Au fond rien de bien nouveau. J’ai vécu des choses similaires dans mes parcours scolaire et professionnel (à une époque où l’ascenseur social fonctionnait, à une époque plus optimiste et enthousiaste) et en effet l’entrepreneuriat technologique vient en bout de chaine des formations scientifiques et des carrières d’encadrement.
Modalités d’entrée dans l’entrepreneuriat
Son analyse en correspondances multiples des créateurs de startup a fortement résonné avec mon vécu de ce monde. Elle les classe notamment en trois groupes : les startpeur·ses indépendant·es ou entrepreneur·ses de carrière, les entrepreneur·ses salarié·es ou entrepreneur·ses par opportunité et les jeunes startpeur·ses ou entrepreneur·ses néophytes [pages 128-131].
Il faut lire l’ouvrage pour entrer dans une description fine de cette population. Certains individus « cherchent à retrouver du sens et de l’autonomie; une logique de recherche de prestige et de distinction sociale ; et une logique stratégique qui les invitent à saisir (ou non) les opportunités qui se présentent » [page 133]. D’autres créent à la suite d’une idée nouvelle avec laquelle ils et elles espèrent pouvoir « changer le monde », ce qui n’est pas sans rappeler la figure de l’entrepreneur schumpétérien [page 136].
Une longue note personnelle ou plutôt quelques notes à ce point de ma synthèse du livre. Depuis des années j’étudie à ma manière les entrepreneurs. J’y ai bâti une sociologie toute personnelle, la plus scientifique possible :
1- c’est un monde élitiste sans aucun doute, plus encore si on se focalise sur les startup technologiques. Difficile de se lancer sans une formation solide, souvent acquise lors d’un doctorat et où l’on trouve très rarement des entrepreneurs autodidactes. (Il ne faudrait pas pour autant oublier cette population-ci, des school dropouts qui ont décidé d’interrompre leurs études pour se lancer dans l’aventure, et Steve Jobs, Marc Zuckerberg ou Dylan Field en sont quelques exemples. Mais attention, ils auraient sans doute fait des études brillantes dans les meilleures universités sans cette interruption). De fait, mon étude principale sur le sujet concerne les entrepreneurs issus de l’Université de Stanford. Peut-on faire plus élitiste ?
2- je découvre enfin une catégorisation d’entrepreneurs qui regroupe d’un côté des néophytes de moins de 30 ans et des entrepreneurs plus chevronnés âgés de 30 à 50 ans. Il est assez rare de trouver pareille analyse et j’ai trop souvent lu que les entrepreneurs sont en général expérimentés avec une moyenne d’âge de 39 ans. Cela me permet de me rappeler d’un côté mon analyse des « serial entrepreneurs » et de l’autre celle de l’âge des entrepreneurs. Là ou Marion Flécher semble montrer (et j’espère ne pas me tromper) qu’en France l’avantage irait à l’expérience, j’ai essayé de montrer que la création de valeur est corrélée à l’inexpérience des créateurs (qui bien sûr ne sont pas seuls au fur et à mesure de leur aventure).
3- Les discriminations de la société sont un sujet cardinal. J’adore mentionner les Lost Einstein, les Marie Curie perdues dans le Morbihan. Je n’ai pas beaucoup plus de solutions que les autres pour y remédier, je ne peux que constater.
Fortunes et infortunes dans le monde des startup
J’en arrive à la partie, selon moi, la plus déprimante de l’ouvrage. Peu d’entreprises innovantes parviennent à se pérenniser – selon certaines études 90% des start-up finiraient par fermer ou déposer le bilan avant leur dixième année – et encore moins atteignent le niveau de croissance espéré pour compter parmi les « licornes » : seules 1% des stargup créées aux Etats-Unis y parviendraient et seulement 25 des 15000 crées en France soit 0,1% [page 147].
La description par l’auteur des levées de fonds (page 155) ou des startup en croissance (page 182) et même des startup en démarrage (page 204) fait parfois froid dans le dos. Difficile de nier ces réalités, même si elles ne sont pas les seules. On y trouvera des expressions telles que la levée de fonds une épreuve de force (page 160), des logiques de cooptation défavorables aux femmes (page 165), faire d’infortune vertu, une stratégie de dominant·es (page 172) du bien-être au contrôle : quand les moments de convivialité conduisent au surinvetisssment des travailleur·ses (page 188), la phase de création : un « joyeux bazar » pas toujours si joyeux (page 205), des stagiaires abandonné·es face à un travail exigeant (page 207), un cadre de travail peu propice à l’émergence de mobilisations collectives (page 228) si bien que le choix se résume à « partir ou rester » (page 232).
Marion Flécher note aussi des conseils généraux de l’écosystème qui m’ont toujours semblé faux pour ne pas dire toxiques, au risque d’en diminuer la qualité et l’échelle des succès potentiels :
– « dans l’univers des startup, l’échec constitute un phénomène à la fois courant et symboliquement valorisé » [page 172] ; je vous encourage pourtant à lire un discours différent par le fondateur de Zendesk qui ne célèbre pas du tout l’échec
– la « capacité à pivoter serait une condition de la réussite des projets entrepreneuriaux » [page 173],
– il est « recommandé aux fondateurs·rices de start-up de constituer des équipes aux profils complémentaires 2il faut surtout pas doubler les compétences » [page 99] , là aussi une vision différentes de l’entrepreneuriat chez Charles Geschke, cofondateur d’Adobe.
La conclusion : les start-up, le nouveau visage du capitalisme
La conclusion est-elle aussi un peu déprimante alors je rajouterai encore quelques notes personnelles !
Les start-up sont un modèle d’entreprise singulier par au moins trois caractéristiques fondamentales (pages 237-243) :
– économique, qui n’est pas orienté vers la recherche de profitabilité mais une croissance forte et rapide par l’innovation, rendue possible par des financements extérieurs,
– organisationnel, qui utilise l’horizontalité, la coopération, l’autonomie et le bien-être
– idéologique, qui valorise l’entrepreneuriat comme le principal moteur de progrès économique et social et le mérite comme principe ultime de la réussite et de la justice sociale
Mais l’autrice a eu pour ambition de déconstruire les idéaux et les promesses en les confrontant à la réalité. Déconstruire
– le mythe du risque et du mérite, qui sert à justifier l’enrichissement de quelques uns en occultant le rôle décisif de l’État,
– le mythe méritocratique du self-made man, qui invisibilise les inégalités d’accès,
– le mythe de l’entreprise libérée, qui en réalité reconduit sous des formes renouvelées des logiques d’exploitation de contrôle et de segmentation du salariat.
A nouveau des commentaires personnels : la loi de puissance et l’exceptionnalité de ce monde ?
L’analyse est correcte mais le tableau n’est-il pas trop noirci. Chacun doit se faire une opinion et les faits doivent y aider. Je suis même surpris que Marion Flécher n’ait pas cité Mariana Mazzucato et son ouvrage The Entrepreneurial State.
Le débat sur ce monde sans aucun doute anormal comme le monde de l’art d’ailleurs n’est pas surprenant. Il est fait plus d’exceptions que de moyennes au point que certains pensent que les statistiques gaussiennes ne s’y appliquent pas. Il faudrait utiliser la loi de puissance.
On est plus proche de la monarchie plus ou moins absolue que de la démocratie. Les fondateurs y sont des quasi-rois. Note additionnelle : dans mes données sur presque 1000 startup (961 pour être précis à date), 60% des CEO sont des fondateurs et même 70% sur le logiciel et l’internet. Et puis 40 CEO femmes seulement… (et pire 88 femmes fondatrices pour 1733 fondateurs)
De fait ni les entrepreneurs ni les investisseurs n’ont des comportements tout à fait classiques. Un seul exemple sur les fondateurs d’Apple : Les deux ne faisaient pas bonne impression sur les gens. Ils étaient barbus. Ils ne sentaient pas bon. Ils s’habillaient bizarrement. Jeunes, naïfs. Mais Woz avait conçu un ordinateur vraiment merveilleux, merveilleux.[…] Et j’en suis venu à la conclusion que nous pourrions créer une entreprise du Fortune 500 en moins de cinq ans. J’ai dit que je mettrais l’argent nécessaire.
C’est un ouvrage important sur les startup. C’est assez rare en langue française, et oute personne intéressée par le sujet devrait lire Le Monde des Start-up.