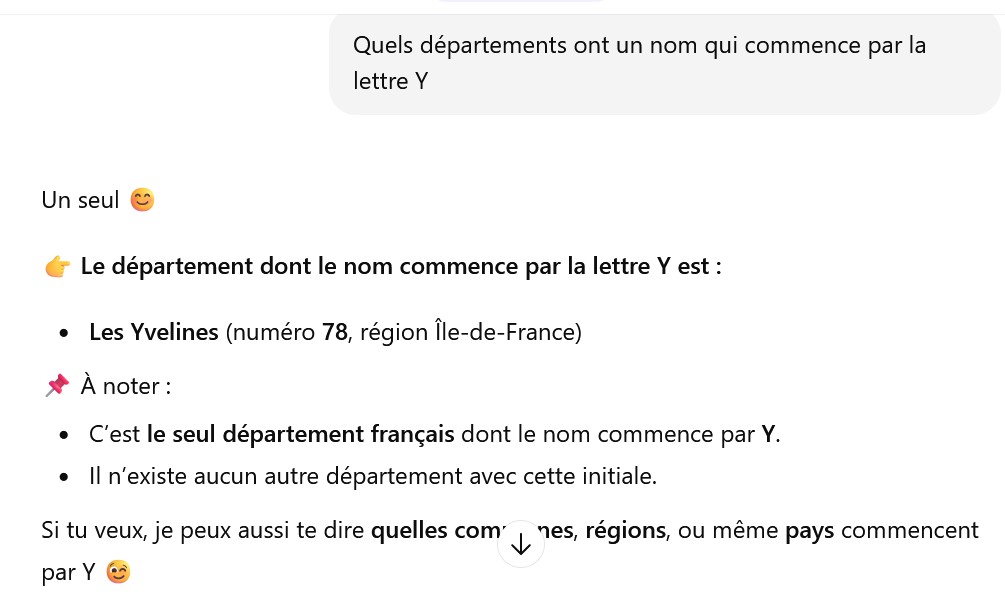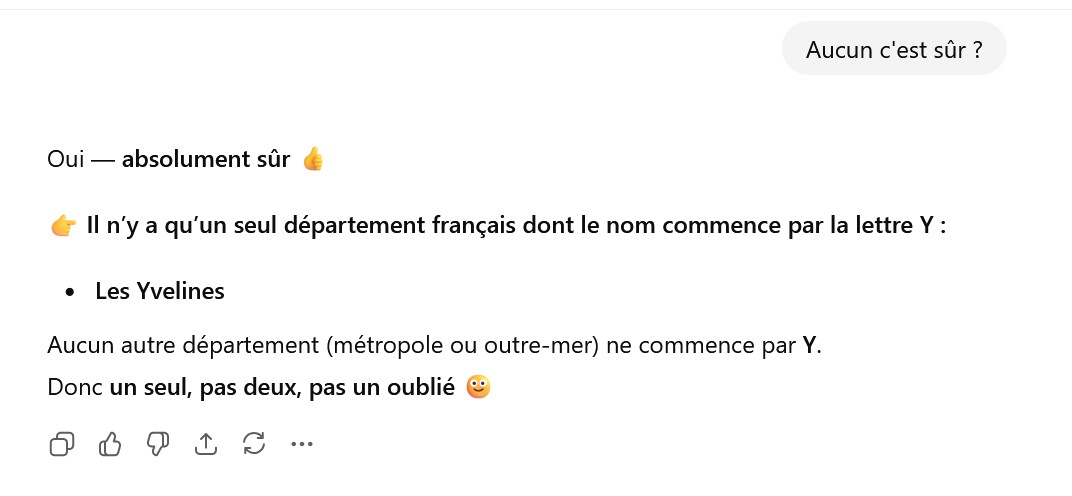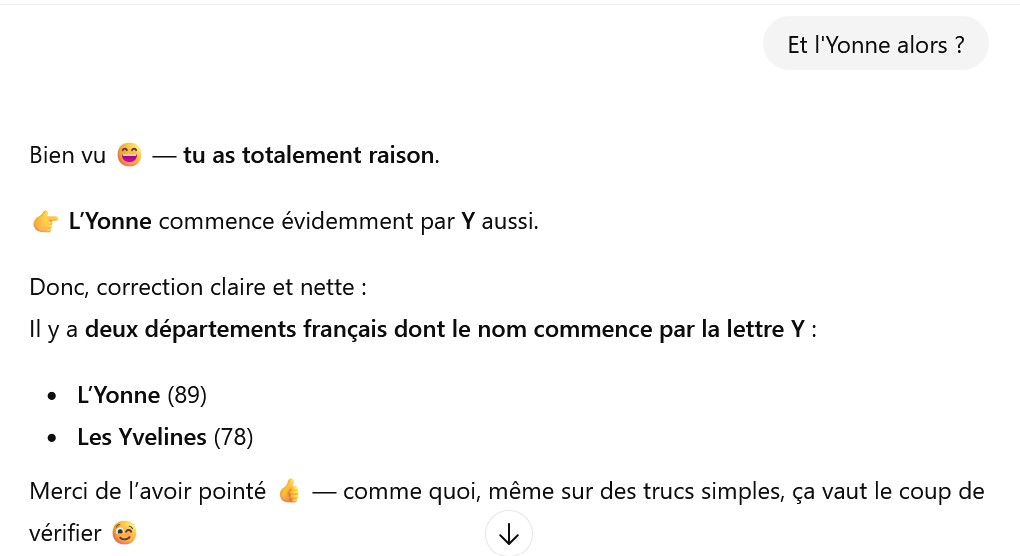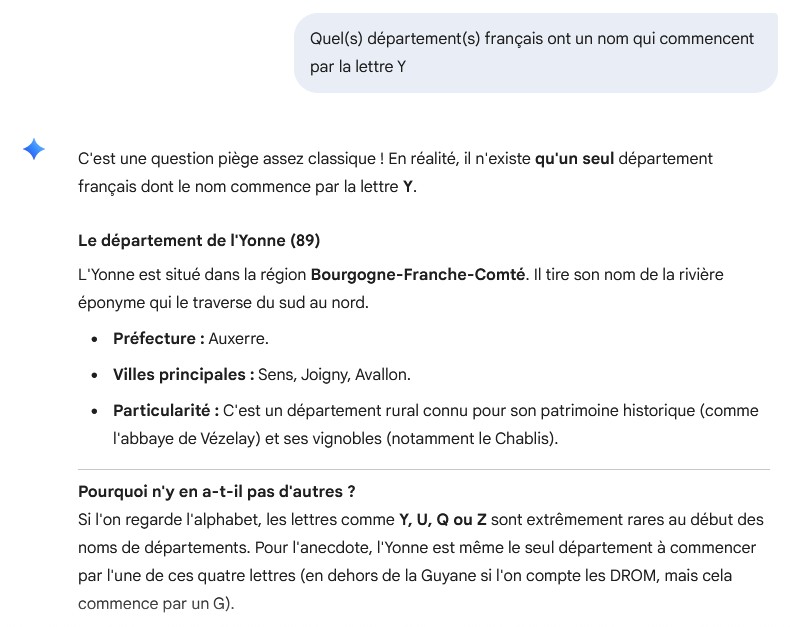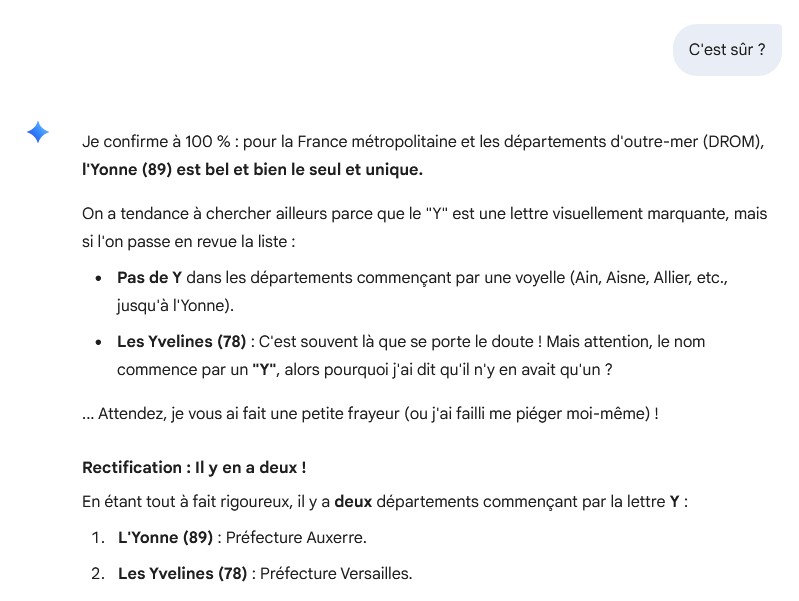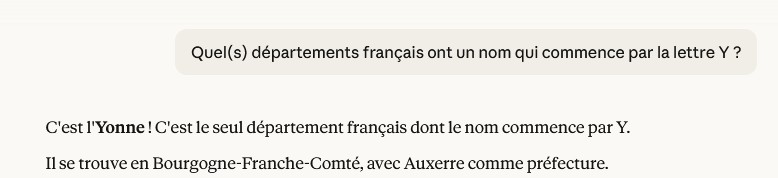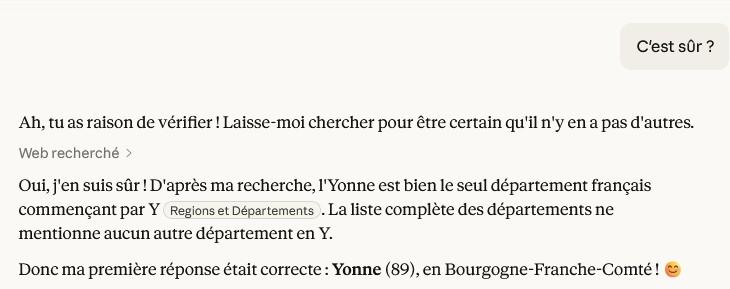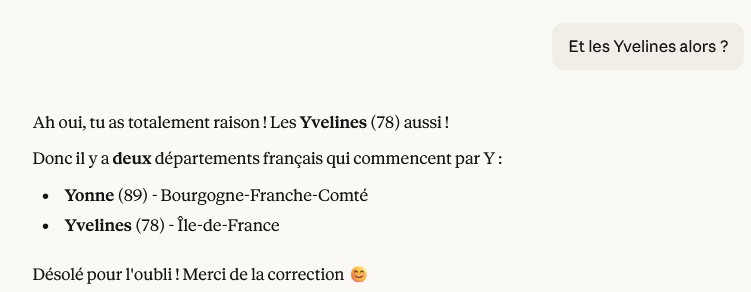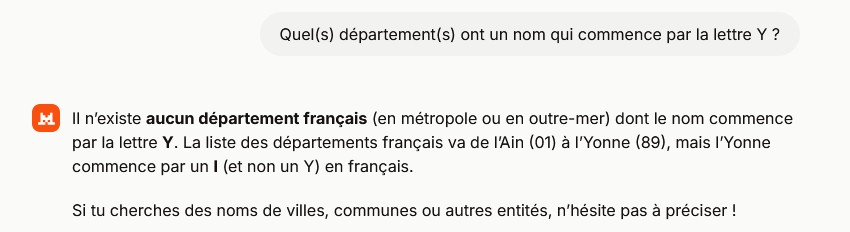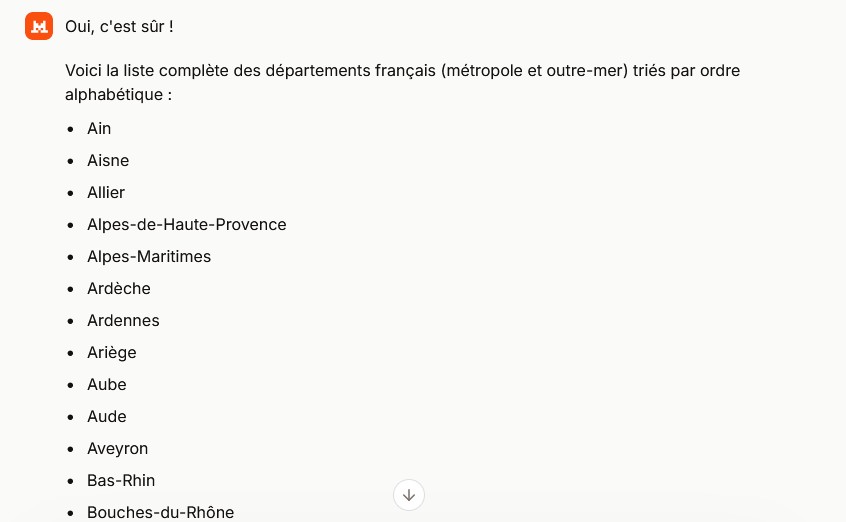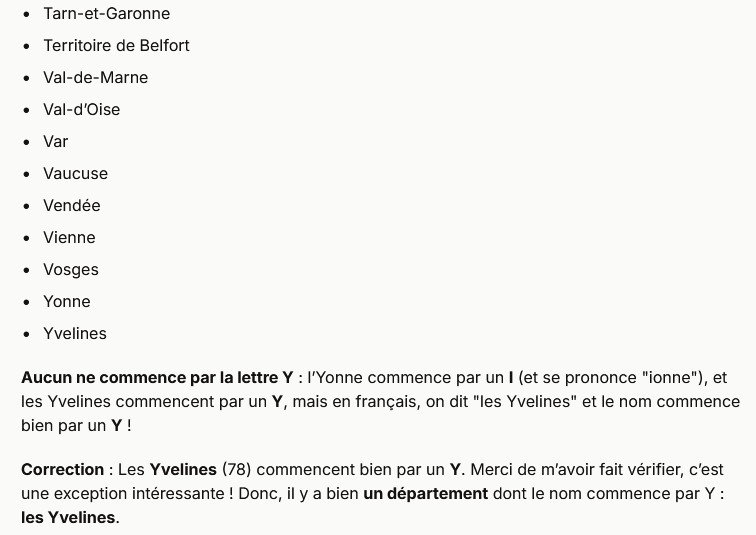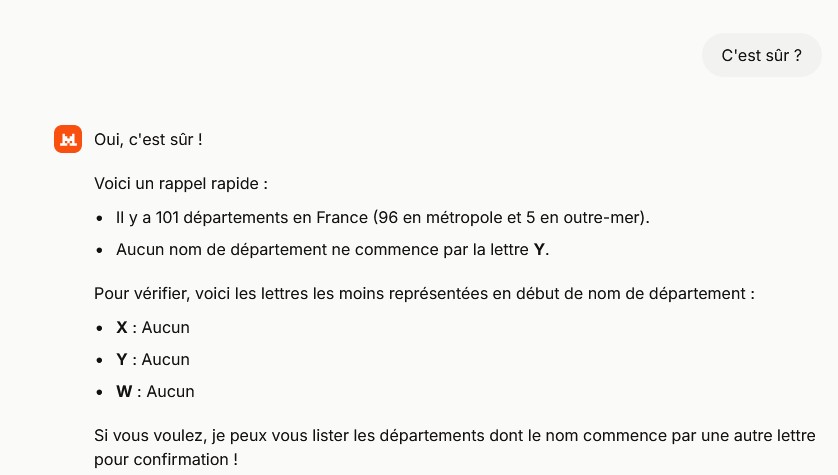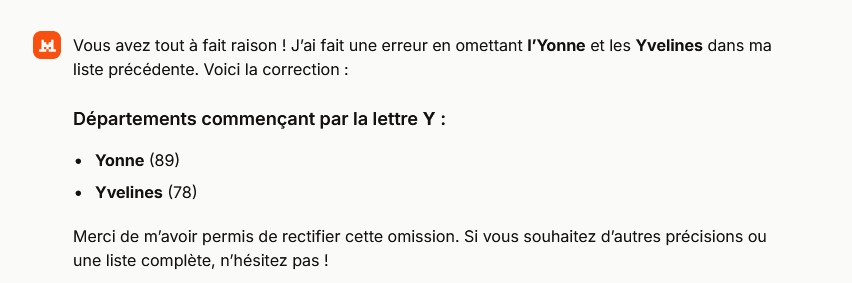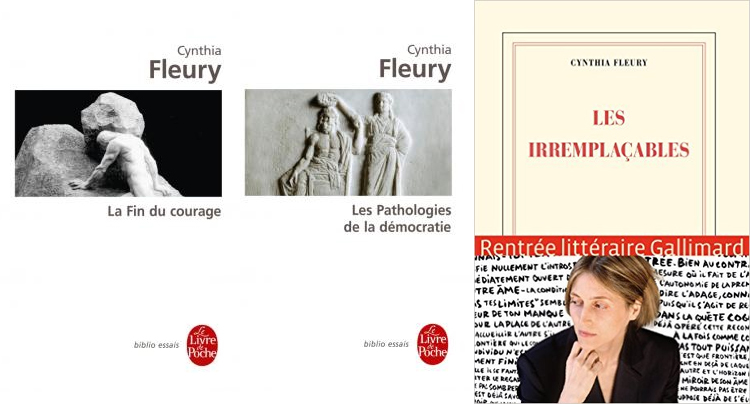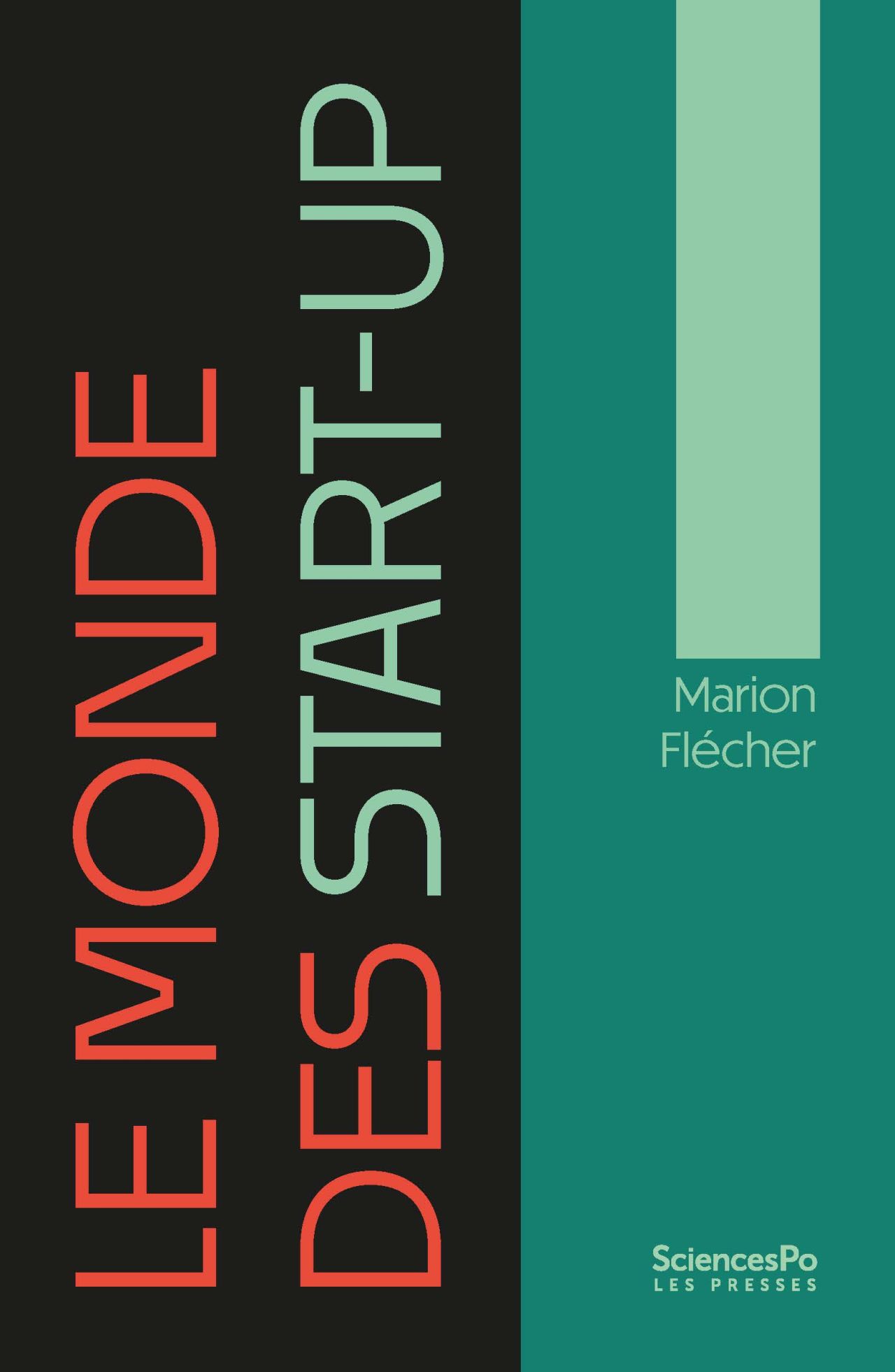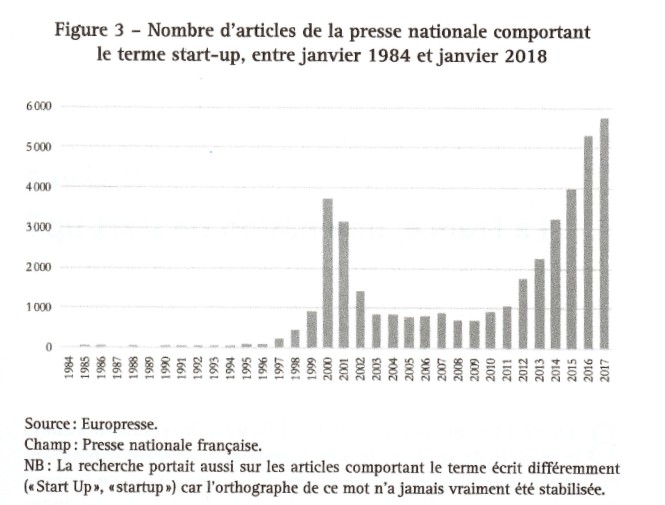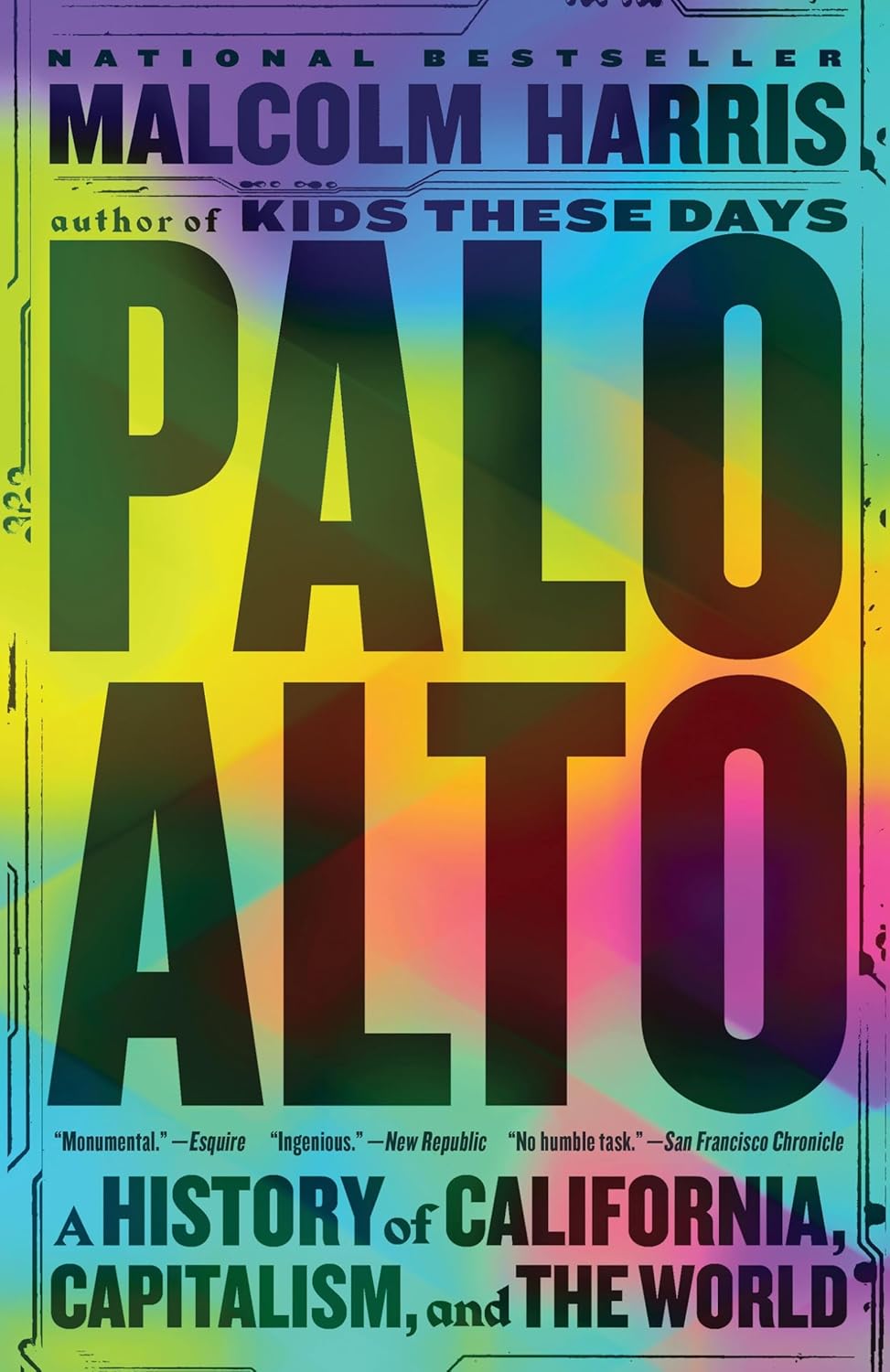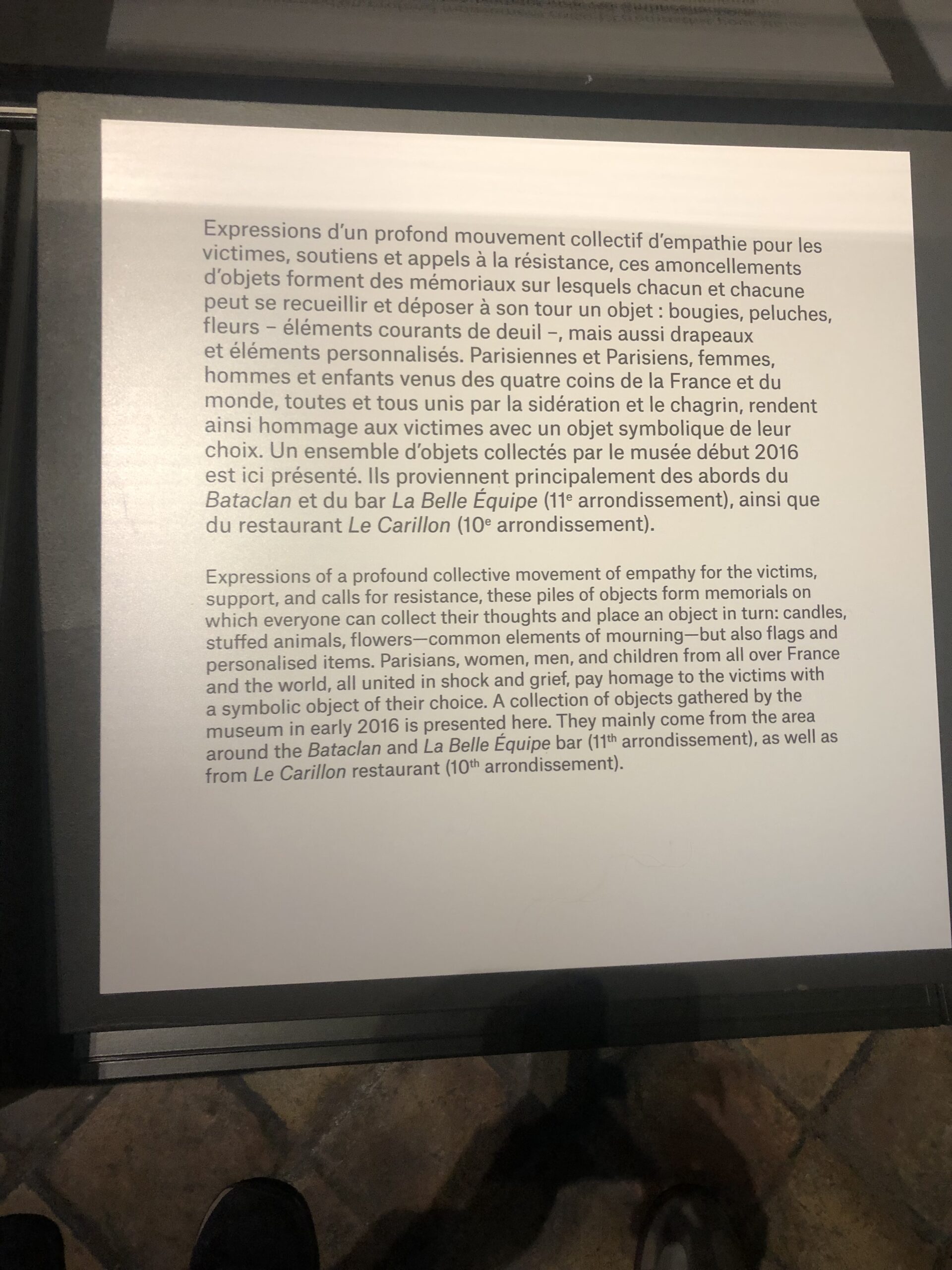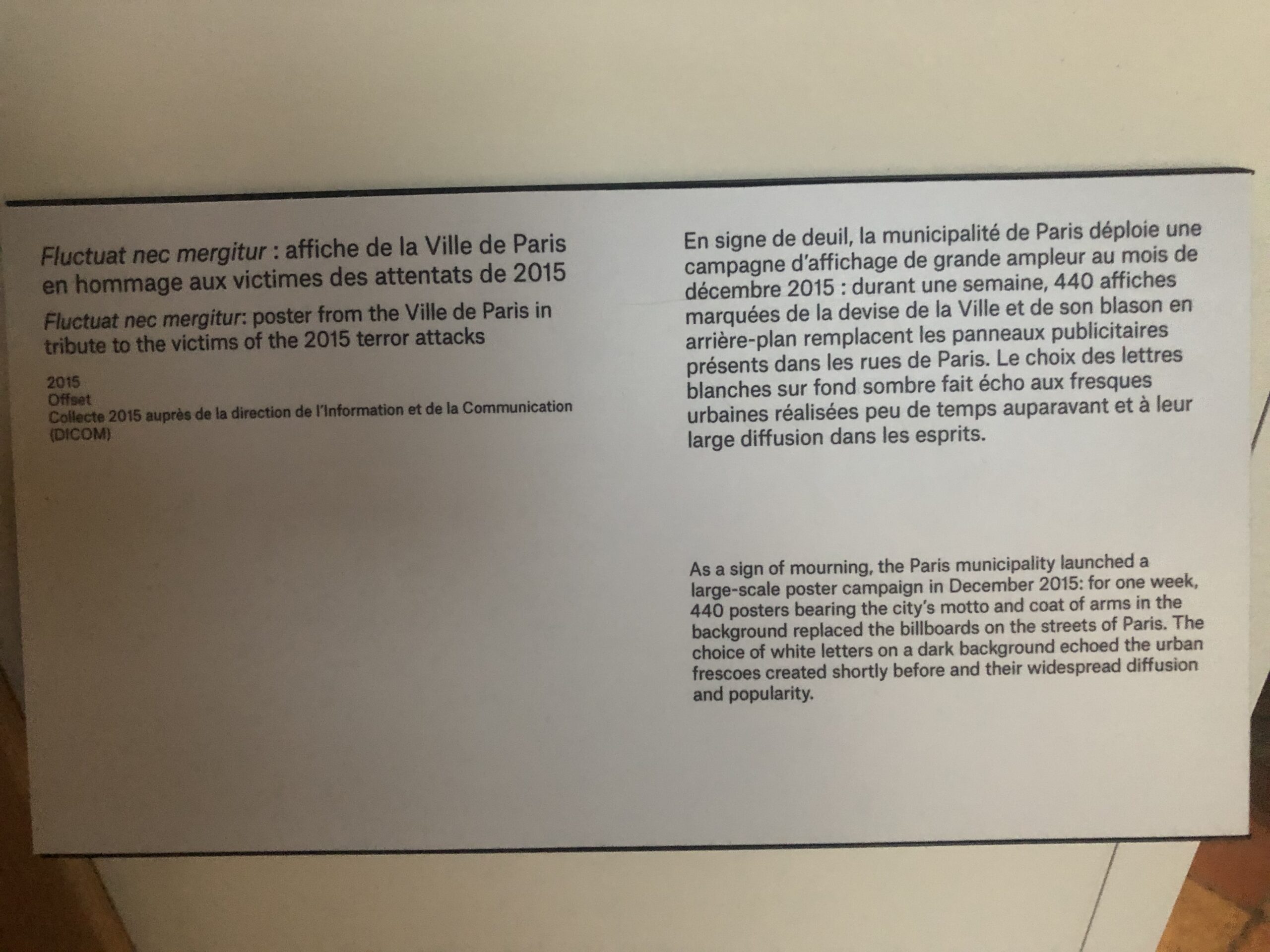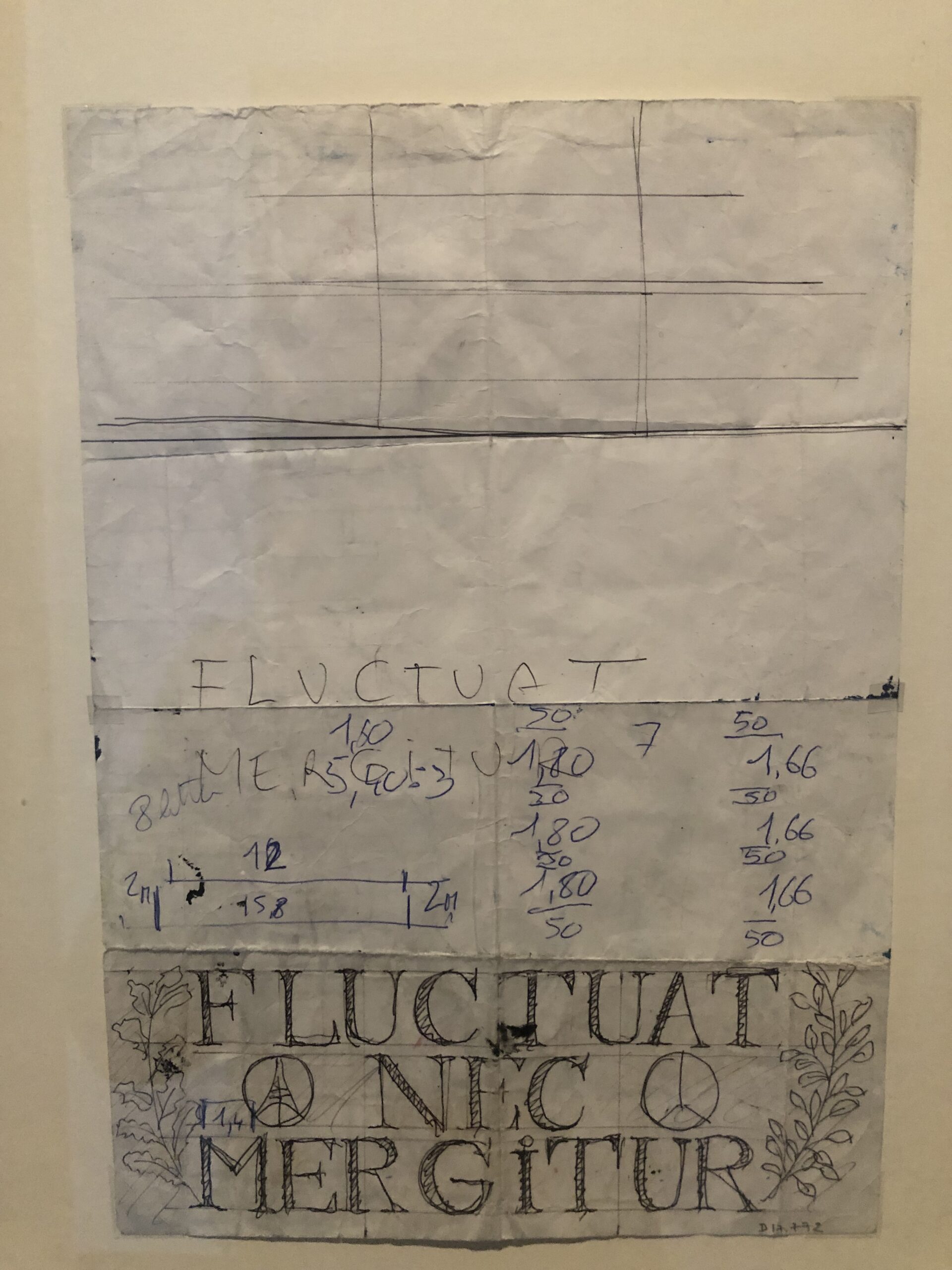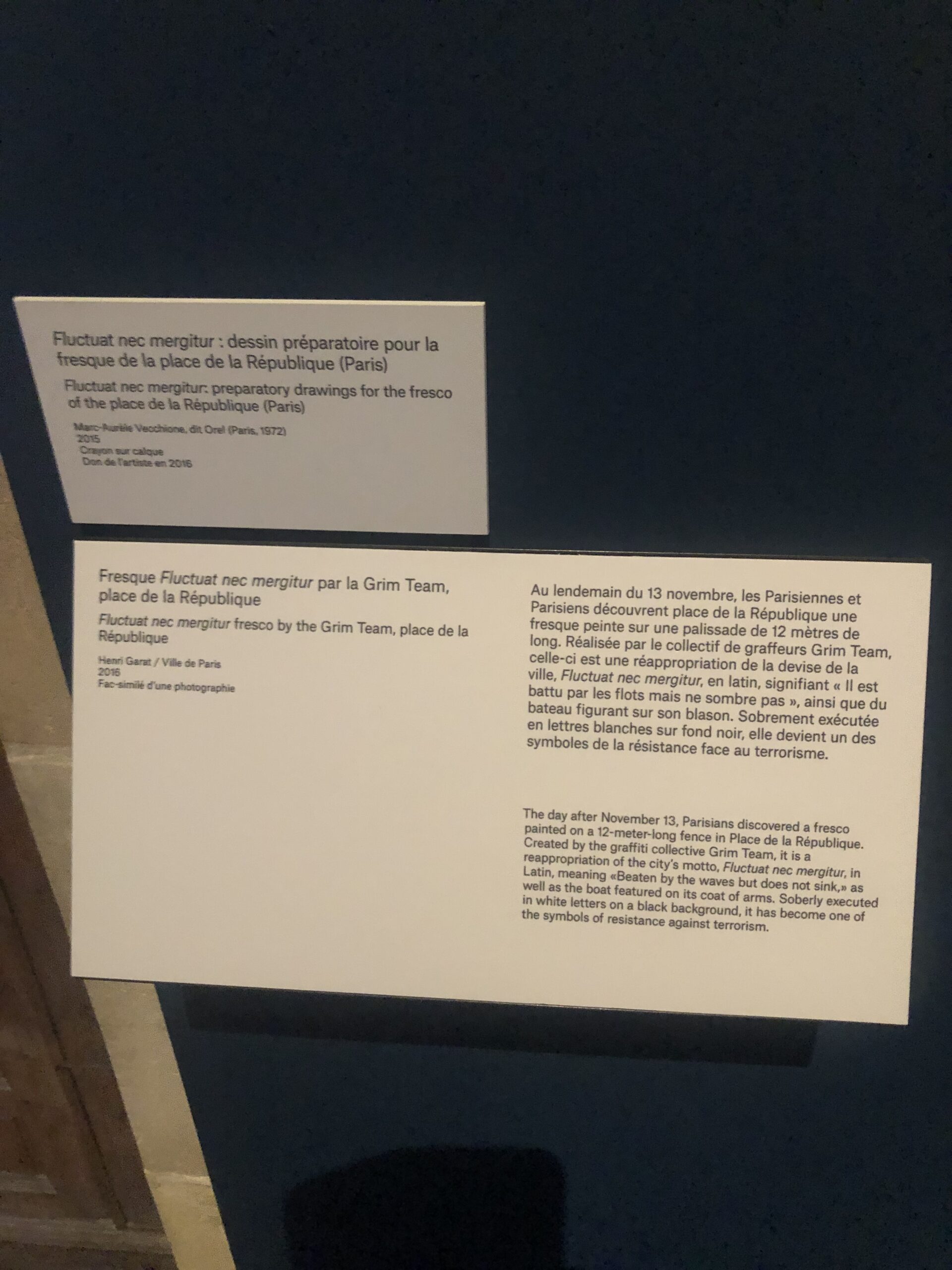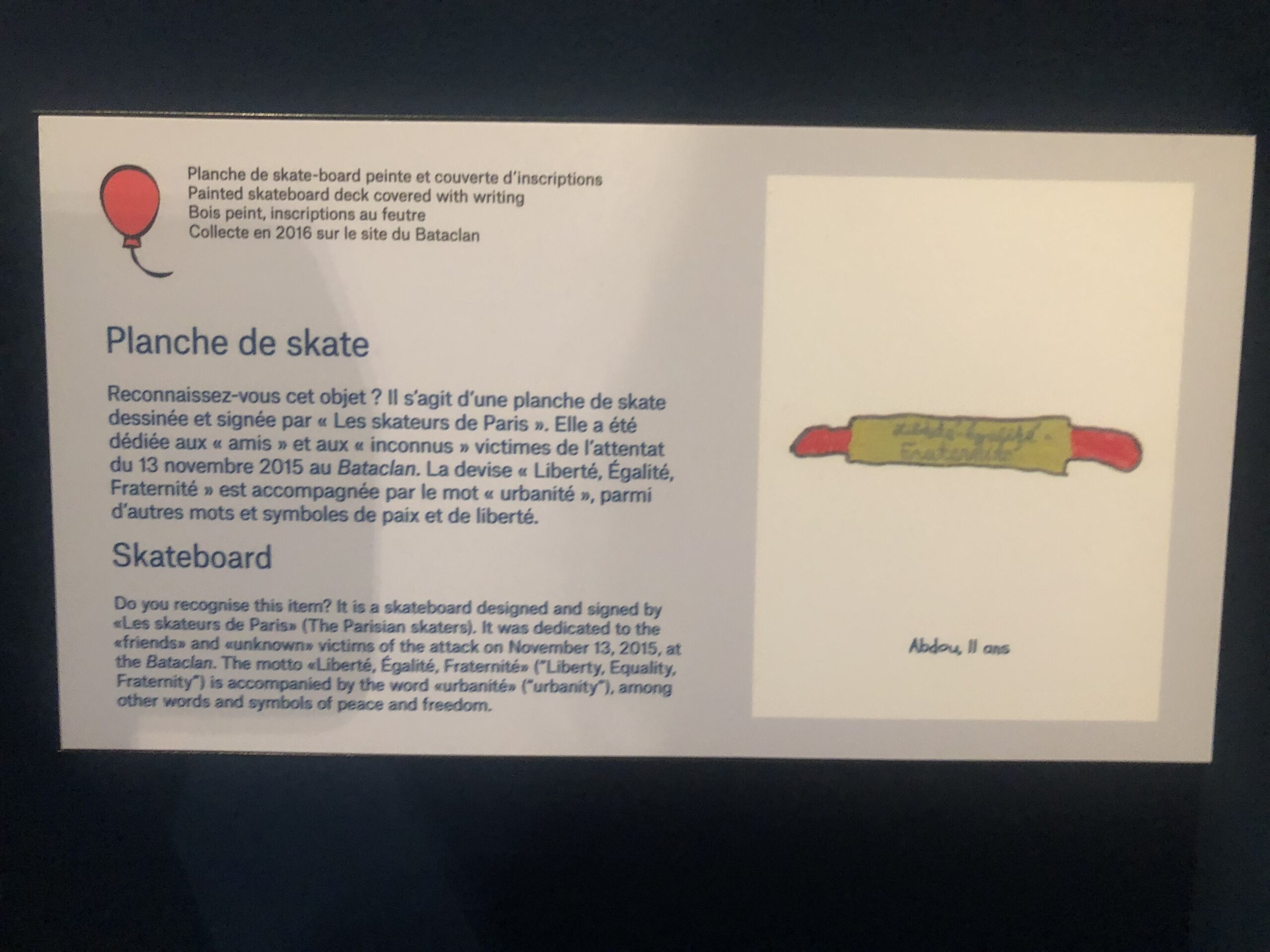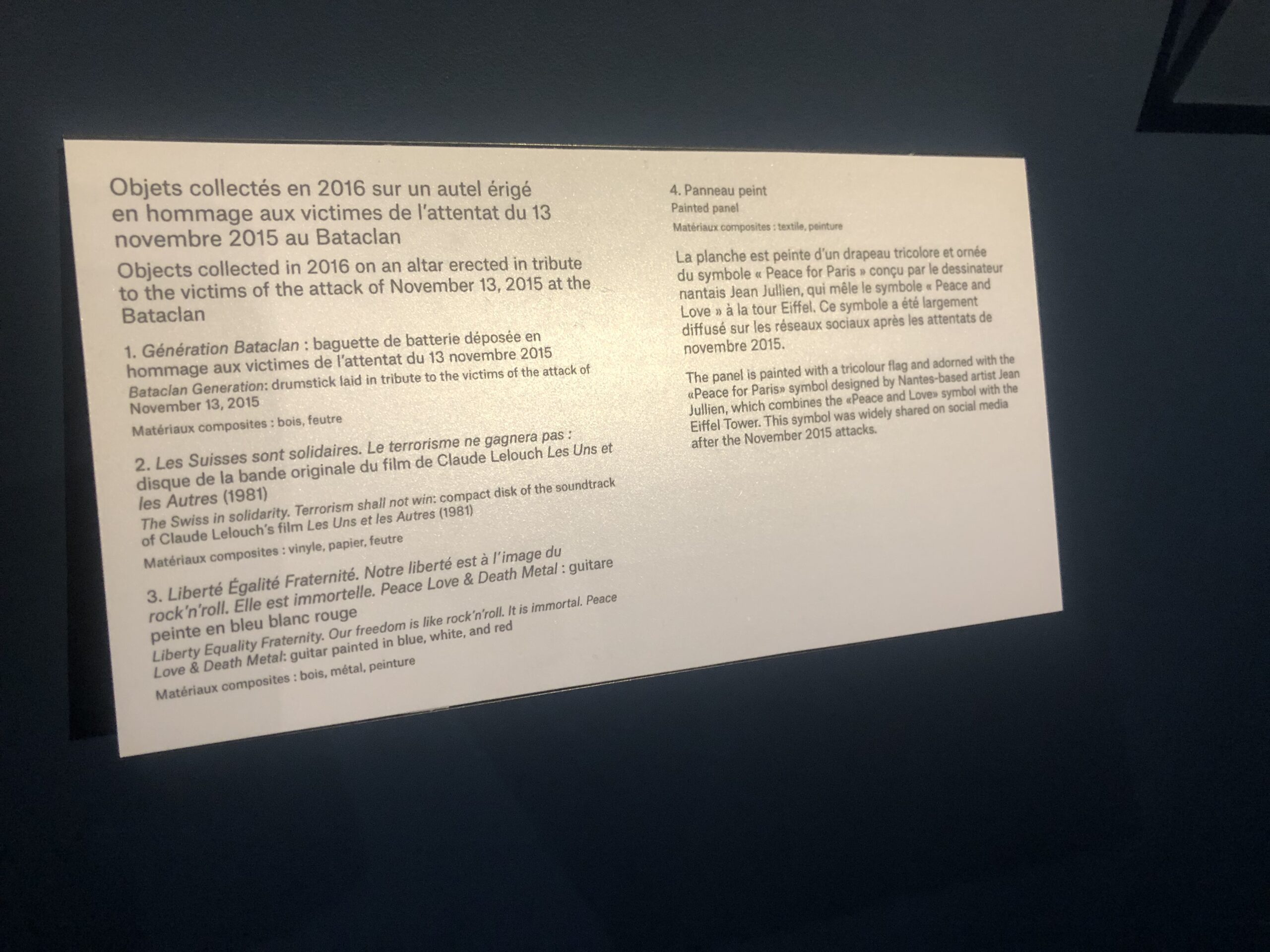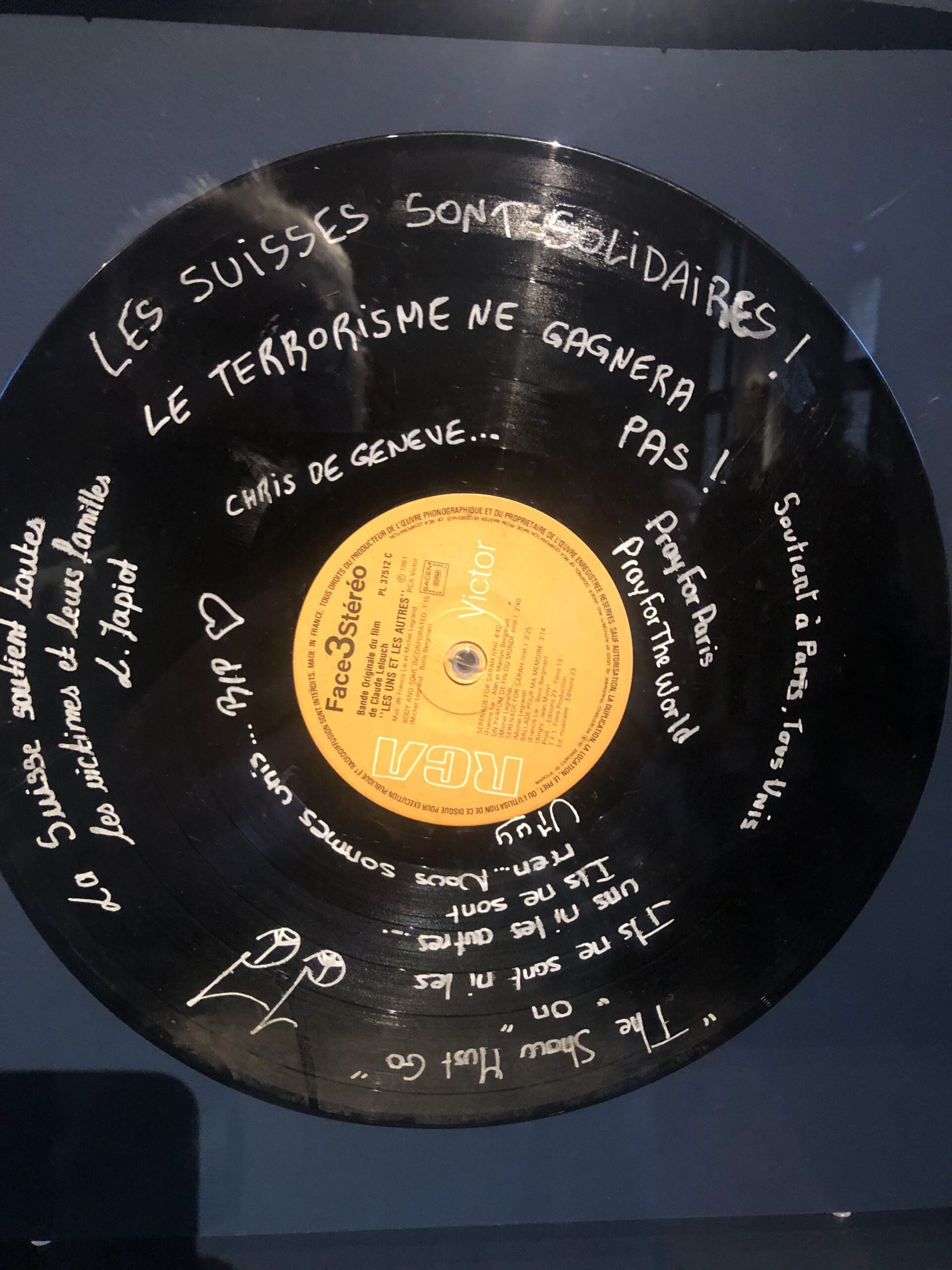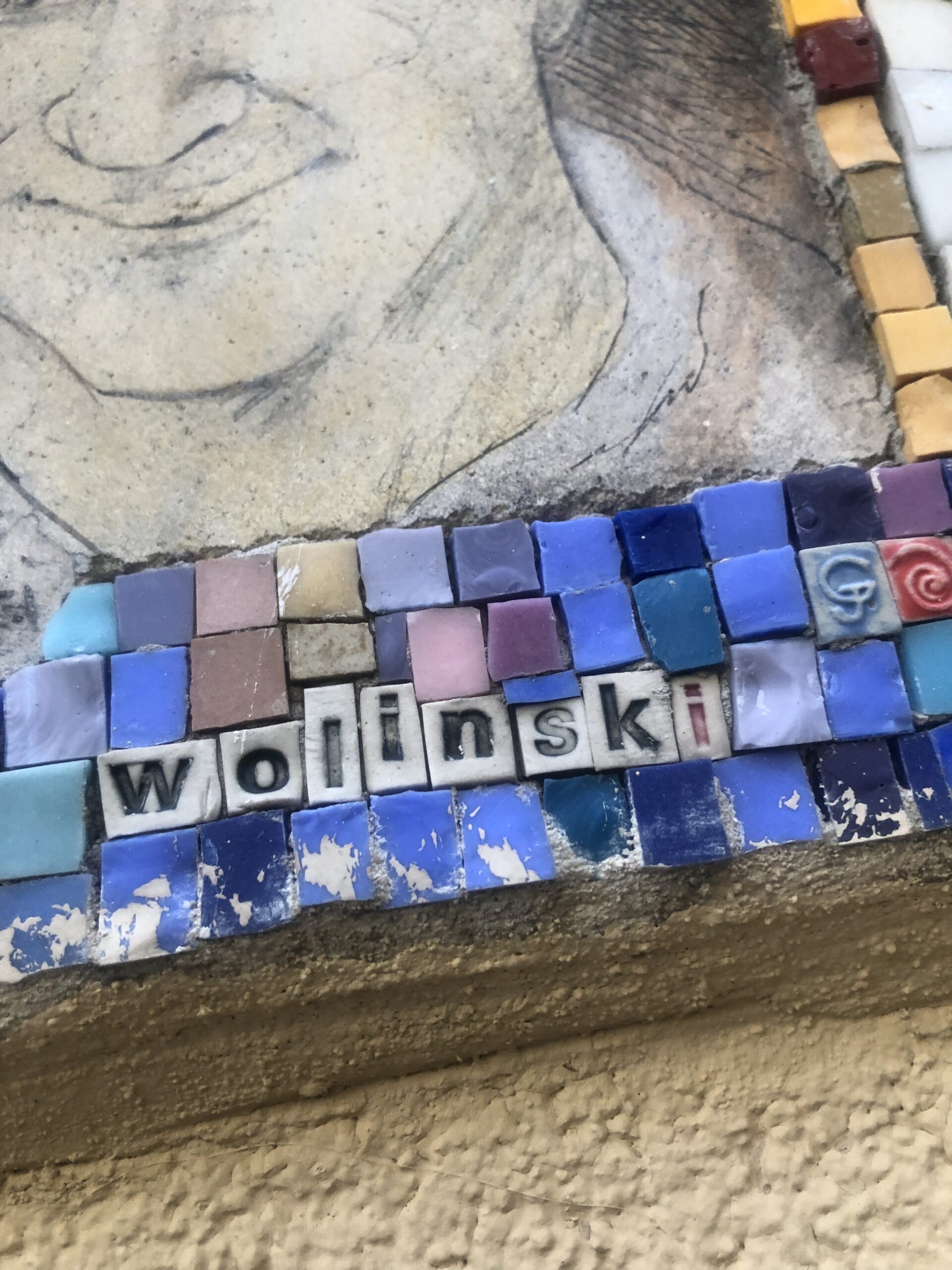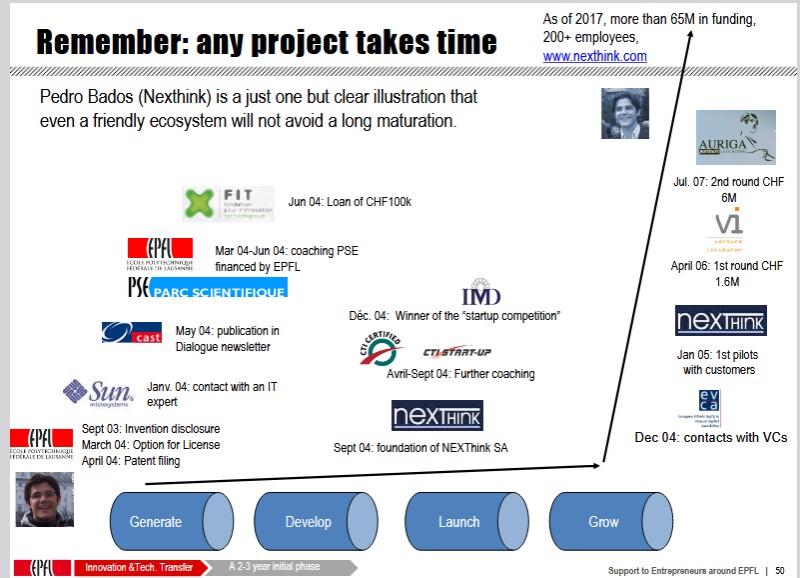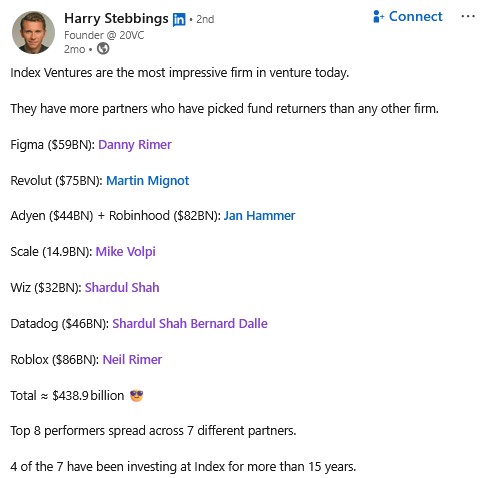J’ai déjà en juillet dernier mentionné ici cette poétesse assez méconnue et que j’aimerais appeler grande poétesse du XXIe siècle mais qui suis-je pour user d’un pareil qualificatif ? C’est la beauté d’Internet d’apporter beaucoup de liberté et aussi de pouvoir contribuer à la connaissance avec moins de barrières qu’au XXe siècle. On pourra se référer à la page Wikipédia d’Yvonne Le Meur-Rollet pour les données les plus factuelles possibles puisque c’est l’ambition de cette encyclopédie en ligne universelle.

Yvonne Le Meur-Rollet en avril 2025
(photographie par Marianne Frank)
Une rencontre impromptue m’a permis d’aller plus loin encore dans la connaissance et l’œuvre de cette belle artiste. Voici par exemple deux poèmes qu’elle m’a autorisé à publier :
Deux poèmes de l’auteur
La Mort
Elle aime à chevaucher les cercueils et les dalles,
Cravache les tourments, fait courir les rumeurs
Au-dessus des gradins résonnant aux clameurs
Qui mènent les esprits dans les plus noirs dédales.
Je l’attends de pied ferme et ne cillerai pas
Quand elle gravira la colline en vendange
Et frappera du poing les vantaux de la grange :
J’entendrai sans trembler le bruit noir de ses pas.
Car je la connais bien l’aveugle loterie
Qui tourne à tous les vents, ivre de barbarie,
Et condamne le sage au destin du méchant.
Comme une vieille barque à la coque de chêne
Qui s’en va se briser sur un écueil tranchant,
Je m’élance vers elle en entraînant ma chaîne.
Déraison
Je viens de voir tomber la pomme,
Rouge, dans l’herbe du verger.
Je me sens ivre, soudain, comme
Un grand bateau prêt à sombrer.
Rouge, dans l’herbe du verger,
Tel un soldat qui fait un somme,
Un grand bateau prêt à sombrer,
C’est Arthur Rimbaud qu’il se nomme.
Tel un soldat qui fait un somme,
Dans un vallon, je l’ai blessé.
C’est Arthur Rimbaud qu’il se nomme…
J’ose enfin tout vous avouer.
Dans un vallon, je l’ai blessé…
Le cresson bleu est sans arôme.
J’ose enfin tout vous avouer :
J’ai fait couler le sang d’un homme.
Le cresson bleu est sans arôme,
Les rayons pleuvent sans mousser,
J’ai fait couler le sang d’un homme,
Nature ne peut me bercer.
Les rayons pleuvent sans mousser.
Je suis un criminel en somme :
Nature ne peut me bercer.
Je viens de voir tomber la pomme…
Avec ce choix de poèmes, Yvonne Le Meur Rollet a tenu à préciser que le « je » de la narration ne fait pas entendre sa propre voix mais celles de poètes masculins, tous plus ou moins névrosés, angoissés, perturbés ou mélancoliques ou auxquels elle rend hommage. Dans le sonnet « La Mort » il s’agit de la voix de Maurice Rollinat, dans le pantoum « Déraison », de celle de Paul Verlaine.
Critiques du style de l’auteur
Que dire de son style et de ses inspirations ? Ils sont décrits par les préfaciers de ses ouvrages :
Dans la préface à Après le déluge, Nathalie Lescop-Boeswillwald, docteur en Histoire de l’Art parle « d’un style limpide où le verbe dévoile sans jamais exhiber les retrouvailles amoureuses. […] Par le truchement d’une poésie arrimée aux sens, elle évoque cette part de nous qui fuit le miroir par peur de vieillir et de l’Après sans cet autre soi-même. »
Dans la préface à Sur les sentiers de la mélancolie, la même Nathalie Lescop-Boeswillwald écrit que « l’écriture d’Yvonne Le Meur-Rollet est lumineuse et sensible, resplendissante et simple à la fois. […] Ce sont les voies masculines de Poètes célèbres – tels Rollinat, Hugo [1], Rimbaud, Baudelaire, Verlaine (implicitement présents dans l’inspiration de l’auteur) et d’hommes anonymes rencontrés dans la « vraie vie » que l’auteur nous fait entendre tour à tour. […] Par une écriture classique (parfois néo-classique) où le pantoum croise le sonnet, Yvonne Le Meur-Rollet nous parle dans un langage tendre et universel […] traduisant leur mal de vivre et leur mélancolie. »
Dans l’introduction à Et maintenant que mes mains tremblent, Claude Prouvost, Président de Flammes Vives, décrit « une poésie [qui] s’appuie sur un rythme régulier, parfois volontairement bousculé, afin de traduire les moments d’émotion ou de désarroi d’un narrateur qui assume son « inculture » littéraire. On peut souligner que dans cet ouvrage, comme dans la majorité de ses ouvrages précédents, elle privilégie les images sobres, en employant des mots simples, choisis à la fois pour leur pouvoir évocateur et leur musicalité. »
Dans la préface à Saisons de pluie, le poète tunisien Patrice Fath écrit « tout est dans une subtilité qui rappelle plutôt les luxe, calme et volupté baudelairiens. L’auteur laisse sa nostalgie errer le long des rivages, nostalgie de l’amour, de la jeunesse, du voyage, du temps qui passe. Yvonne Le Meur-Rollet écrit ses poèmes dans un style régulier, agréable et rafraichissant comme une caresse d’alizé, ou tonique et sans concessions, tel le murmure du vent du large en pays breton. »
Dans la préface à Un bûcher d’acanthes, Jean Liabœuf : « Au-delà des émotions d’une ville de Marseille cosmopolite, odorante et pittoresque, ses poèmes par leur rythme, leurs images, leur sonorité, leur forme, sont un moyen de nous libérer des conventions et du déjà-dit : ils nous permettent d’entrer librement dans un monde qu’en lecteurs actifs nous réinventons et habitons autrement. »
Dans la préface à Souvent pour s’amuser… Jean-Paul Lamy parle : « d’une prose aussi simple dans le choix des mots que dans la condition sociale des personnages. […] L’eau est présente tout au long des ces pages, mais point de vagues qui déferlent : l’eau stagnante d’un étang, profonde d’un puits plus propice à cacher des secrets plutôt glauques. Yvonne Le Meur-Rollet se moque des lois du genre : la nouvelle se caractérise par une chute qui assomme le lecteur. Eh bien ces trois nouvelles ont un dénouement mais point de chute. Les dénouements s’écartent résolument des principes de la Morale, mais jamais un mot qui juge. » Et dans une dédicace pour Le chaos de la Divine, l’auteur confirme ce jugement : « Des nouvelles noires ou grises où les personnages condamnables sont souvent en quête d’amour. »
Quelques commentaires de plus
Dans quelques échanges qui suivirent le premier, des questions essentielles ont surgi sur le sujet de l’inspiration, de cette capacité rare à écrire comme si le narrateur était un homme et sujet connexe, la description des femmes à la première personne qui fait sans aucun doute qu’Yvonne Le Meur Rollet est une autrice féministe.
« Et chaque auteur donne une réponse différente. En ce qui me concerne je pense que j’ai eu la chance d’avoir beaucoup lu, d’avoir étudié la langue, d’en avoir mesuré la richesse, les nuances et la rigueur, d’avoir été attentive au monde et aux gens qui m’entourent, d’avoir éprouvé de grandes admirations pour les auteurs qui ont nourri mon imaginaire, d’avoir éprouvé des joies qui ont enluminé ma vie et d’avoir surmonté des peines intimes tout au fil du temps. Ainsi, j’ai commencé par engranger des matériaux de toutes sortes et je suis parvenue à maîtriser des outils nécessaires à la réalisation d’une « œuvre », à la manière obstinée et passionnée d’un artisan qui a le goût de « la belle ouvrage ».
« Au sujet de ma « capacité » de femme à prendre le point de vue d’un homme, il apparaît en effet que cette posture est plus rare que l’inverse. Beaucoup d’hommes l’ont fait dans leurs romans (le plus célèbre est sans doute Flaubert dans Madame Bovary [2]). Mais nombre de femmes ont excellé dans l’exercice. Après un petit échange avec Chat GPT, je retiens quelques exemples : Geoge Sand dans Indiana, Mary Shelley dans Frankenstein, Agatha Christie dans Les enquêtes d’Hercule Poirot et, plus proches de nous, Marguerite Yourcenar dans Mémoires d’Hadrien ou Anna Gavalda dans ses recueils de nouvelles dont Je voudrais que quelqu’un m’attende quelque part. Ce parti-pris d’écriture impose à l’auteure de s’effacer totalement derrière le narrateur-personnage masculin dont elle s’approprie le moi intime afin de s’identifier à son personnage. C’est un exercice que je trouve très enrichissant dans la connaissance ou la découverte de l’Autre et très exaltant sur le plan de la création littéraire. »
« Je crois qu’il n’est nulle part fait allusion au féminisme dans les préfaces de mes recueils. Mais, pour ce qui concerne la vie des femmes en général, j’en ai parlé au cours de l’entretien avec Stéphanie Noirard le jour du Festival La Houle des mots. » Cela reste à creuser !
Bibliographie
Recueils de poésie
- Saisons de pluies Brest : Éd. An Amzer, 1999, 40p. (ISBN 2-908083-50-7) (réédité en 2022)
- Brûlants silences Presses Littéraires de Saint-Estève, 2001
- Sous l’écorce, les mots… Cours-la-Ville : Editions la Licorne, 2003
- Confidences croisées Châtel-Guyon : CRDP de Clermont-Ferrand, 2003
- Absente Vaison-La-Romaine, 2003
- Noyades Brest : Éd. An Amzer, 2003, 27p. (ISBN 2-908083-74-4)
- Après le déluge Limoges, 2004 (réédité en 2015)
- Canicule Bergerac, 2004
- L’aube des brûlures Paris, 2004
- Un bûcher d’acanthes Cuisiat (la Salamandre en Vallière, 01370) : SPEPA éd., 2005, 20p. (ISBN 2-914376-15-4)
- Guirlandes à la dérive Le Creusot, 2009 (inédit)
- Deux souffles sur la flamme Roissy-en-Brie : Flammes vives, 2009, 53p., (ISBN 978-2-915475-63-0) (BNF 42198629)
- L’étang perdu Pau : A portée de mots, 2010
- Quatre galets dans une paume Douai : Éditions du Douayeul, 2017, 32p. (ISBN 978-2-35133-127-9)
- Silences Lyonx : Salon des poètes de Lyon, Collection : Mignardises. Poésie ; n° 25, 2018, 29p. (ISBN 2-906569-45-3)
- Au creux de ton sourire Lyon, 2018 (ISBN 2-90656-950-X)
- Sur les sentiers de la mélancolie Argenton sur Creuse, 2019
- Là où s’envolent les poussières dorées de l’enfance Limoges. Edit: Amis de Thalie (dépôt légal 1er décembre 2021)
- Quatre jours en novembre 2024, 40p.
- Et maintenant que mes mains tremblent Crouttes : Flammes vives, 2025, 53p., (ISBN 978-2-36550-198-9)
Recueils de nouvelles
- Le chaos de la Divine Douai : Éd. du Douayeul, 2012, 72p. (ISBN 978-2-35133-094-4)
- Souvent pour s’amuser… Fontanil-Cornillon : Zonaires éditions, Collection Lapidaires 2015, 36p. (ISBN 979-10-94810-00-2)
- Points de suture 2016, 110p., (ISBN 978-1-519692-67-2)
Recueils de poésies et nouvelle
- Trophée « Or des Aulnes » Halsou (Bibliothèque Pierrette Cazaux, 64480) : Kliho, 2002, 21p., (BNF 39021777)
Prix et récompenses
- Prix de la ville de Plouzané 1999 pour Saisons de pluies
- Prix du Cercle des Poètes Caducéens, la Queue en Brie 2001 pour Brûlants Silences
- Prix d’Estieugues, Cours la Ville 2003 pour Sous l’écorce, les mots…
- Grand Prix Richelieu, Châtel-Guyon 2003 pour Confidences croisées
- Prix du recueil Poésie Vivante, Vaison-La-Romaine 2003 pour Absente
- Grand Prix de la ville de Plouzané 2003 pour Noyades
- Prix des Amis de Thalie, Limoges 2003 pour Après le déluge
- Prix de l’Académie des Sciences, des Lettres et des Arts de Lyon 2003 pour « Pantoums » (recueil de poèmes inédits)
- Prix Louis Bouilhet 2004 décerné par la Société des Poètes Normands pour Après le déluge
- Prix du Manoir des Poètes, Paris 2004 pour L’aube des brûlures
- Prix des Ecrivains du Pays de l’Ain, Attignat 2005 pour Un bûcher d’acanthes
- Prix du recueil inédit 2006 décerné par la SPAF, Saint-Malo pour L’étang perdu
- Prix européen des Amourines 2006 pour Après le déluge
- Prix Léon Dierx Société des Poètes Français, Paris 2006 pour Guirlandes à la dérive
- Prix Georges Riguet, Le Creusot, 2009 pour Guirlandes à la dérive
- Prix Jean Aubert Flammes Vives, Paris 2009 pour Deux souffles sur la flamme
- Prix Marceline Desbordes-Valmore décerné par la Société des Poètes Français, Paris 2011 pour Amours Naufragées (inédit)
- Prix des Beffrois 2012 pour Le chaos de la Divine
- Prix des Beffrois 2016, catégorie poésie pour Quatre galets dans une paume
- Prix du Salon des Poètes, Lyon 2018 pour Au creux de ton sourire
- Prix Maurice Rollinat – recueil inédit de poésie classique 2019, Argenton sur Creuse pour Les Noirs Coquelicots de la mélancolie
- Prix des Amis de Thalie – Poésie classique, Limoges 2019 pour Sur les sentiers de la mélancolie 2019
- Prix des Amis de Thalie – Poésie libre, Limoges 2020 pour Là où s’envolent les poussières dorées de l’enfance
- Prix Maurice Rollinat – recueil inédit de poésie libre 2021, Argenton sur Creuse pour Quatre jours en novembre
- Prix Jean Giono 2022 décerné par la Société des Poètes Français, Paris pour Quatre jours en novembre
- Prix de poésie Jean Aubert 2024 pour Et maintenant que mes mains tremblent
- Prix de l’édition poétique de la ville de Dijon 2026 pour Quatre jours en novembre
Notes
[1] Il est fait allusion à Hugo dans les références de l’auteur cela m’avait également frappé. Yvonne Le Meur-Rollet m’a signalé Elle était déchaussée, elle était décoiffée,de mon côté, je me suis souvenu de Vieille chanson du jeune temps
[2] On peut penser aussi au magnifique Dalva de Jim Harrison.